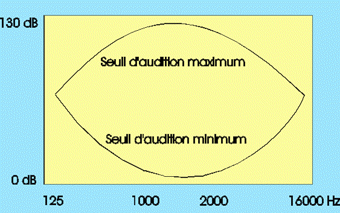2 - Propriétés physiologiques du son.
Pars
1
Chap
2
In
« Contribution à l’étude de la latéralité auditive
Dr
Yamina Guelouet, PhD, MD, Psychiatre
UPS Toulouse 84 – N°30
C H A P I T R E
I
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE
SON »
1 – A - Propriétés physiques des sons en général
1 – B - Propriétés physiques des sons complexes.
1 – C - Propriétés du langage.
Deux sons peuvent différer entre eux
par leur intensité, leur hauteur et leur timbre.
*Intensité ou sonie.
------------------
Le mot sonie désigne la sensation qui correspond à un son fort ou faible. Elle est à distinguer de l'intensité physique qui correspond à la puissance surfacique acoustique comme nous l'avons vu lors du rappel des propriétés physiques d'un son.
| |
Bien qu'il soit facile de constater
qu'elles varient toutes deux dans le même sens, il n'y a pas de rapport simple
entre cette puissance surfacique et la sensation sonore.
Avec
WEBER, la psycho‑physique propose
de mesurer la sensibilité à l'intensité en formulant qu'une variation de la
stimulation devient sensible à notre
perception lorsque pour chacune des valeurs I de cette stimulation le rapport ![]() est constant.
est constant.
Cette constante traduit la quantité
nécessaire d'augmentation de l'intensité de la stimulation pour parvenir à
percevoir une modification sensorielle.
FECHNER
admit que la sensation représentait globalement la somme de toutes les
augmentations perçues lors des variations croissante de la stimulation
S = ![]() .
.
La sensation croit à peu près comme le
logarithme de la stimulation. C'est une loi très approchée qui n'est à peu près
exacte que dans la zone des intensités acoustiques et des fréquences moyennes.
Cette loi est de la forme
S = K log I
où K est la constante propre à chaque mode d'excitation sensorielle. Les augmentations d'intensité sonore pour parvenir à une variation de sensation s'expriment en décibel.
Seuil absolu.
C'est la puissance acoustique la plus
faible capable de produire une sensation sonore.
Le seuil absolu varie avec la fréquence
du son et passe par un minimum très aplati entre 1000 Hz et 5000 Hz.
Si l'on augmente la puissance surfacique d'un son, la sensation sonore devient douloureuse. On peut alors tracer la courbe des seuils douloureux en fonction de la fréquence et de la puissance. La surface comprise entre la courbe de seuil d’audibilité et celle du seuil douloureux constitue le champ auditif
tonal.
Ceci peut être représenté graphiquement par une courbe de WEGEL ou mieux par la courbe de FLETCHER et MUNSON (figures 2 et 3).
A partir de ces courbes, on peut faire
les remarques suivantes
a/ Le
seuil absolu à 1000 Hz de 10![]() watt/m2 pour le sujet moyen a été choisi comme niveau pour
les décibels absolus. Le seuil est inférieur à zéro pour les fréquences de
2000 à 4000 Hz .
watt/m2 pour le sujet moyen a été choisi comme niveau pour
les décibels absolus. Le seuil est inférieur à zéro pour les fréquences de
2000 à 4000 Hz .
b/ Entre la puissance de seuil et la
puissance produisant une sensation douloureuse, le rapport est de 10![]() .
.
* Hauteur ou tonie.
-----------------
Les sons se distinguent les uns des
autres, indépendamment de leur intensité, par leur hauteur ou tonie qui dépend
de la fréquence du mot vibratoire et qui est l'analogue de la couleur pour les
sensations visuelles.
C'est la propriété qu'on exprime en
disant qu'un son est plus ou moins grave, ou plus ou moins aigu.
On exprime généralement la hauteur d'un
son par rapport à la fréquence du La (435 Hz) prise comme référence.
Si les fréquences sont dans le rapport
2, le son qui a une fréquence double de celle de l'autre est à l'octave de celui‑ci.
|
|
|
Fig (2)Courbe de WEGEL (le seuil maximum est aussi appelé « seuil
de la douleur » |
|
|
|
Fig(3) Courbe de Fletcher et Munson |
Chaque octave est divisé en intervalles
repérés par les notes qui forment la gamme.
*Le timbre.
----------
Le timbre est
la qualité d'un son qui permet de le différencier d'un autre son de même
hauteur et de même sonie mais émis par un autre instrument. Cette qualité
provient du fait que les sons complexes contiennent à côté du fondamental des
partiels. Lorsque ces partiels sont des multiples entiers de la fréquence du
fondamental, ils sont appelés harmoniques. La présence de certains harmoniques,
leur renforcement ou leur atténuation caractérisent le timbre qui personnalise
le son. La sensation de timbre est donc liée au spectre du son. L'impression
subjective de timbre s’identifie donc à la forme plus ou moins complexe de la
courbe représentative du mot périodique, qui peut être considéré comme la
somme de courbes sinusoïdales élémentaires convenablement choisies. Cette
décomposition mathématique d'une fonction périodique complexe en fonctions
sinusoïdales simples correspond à la sensation physiologique de timbre.
*Sons subjectifs.
---------------
Lorsqu'un son pur, donc sans harmonique
et de puissance suffisante agit sur l'oreille, celle‑ci entend également
les premiers harmoniques.
Si deux sons de fréquence respective fl
et f2 arrivent simultanément sur
l'oreille, celle‑ci perçoit non seulement f 1 et f 2, mais aussi un son
de fréquence f1 - f2 qui est le différentiel et plus faiblement f1 + f2 qui
est le son additionnel .
Quelqu'en
soit le mécanisme, ces sons subjectifs contribuent à donner aux sensations
sonores leur caractère de dissonance ou de consonance.
*Effet de masque.
---------------
Lorsque le bruit ambiant devient trop
intense, l'audition des sons désirés devient pénible. Il y a effet de masque.
Pour continuer la conversation, on élève la voix et on la rend plus aiguë.
Ainsi, le seuil d'audition d'un son S
s'élève lorsqu'on entend simultanément un son S![]() de niveau plus élevé que S. Cette élévation du seuil dépend
de l'intensité et de la fréquence de S
de niveau plus élevé que S. Cette élévation du seuil dépend
de l'intensité et de la fréquence de S![]() .
.
S est dit son masqué.
S![]() est dit son masquant.
est dit son masquant.
Si on se limite à l'effet masquant des
sons purs sur les sons purs, on peut dégager un certain nombre de lois :
- l’effet de masque est maximal pour
les fréquences voisines de celles du
son masquant.
- l'effet de masque est négligeable
tant que le niveau de masque est faible.
-
l'effet de masque croit beaucoup plus vite que le niveau de son masquant.
- les
fréquences basses sont les plus gênantes.
- les
fréquences aiguës sont les plus gênées.
Les bruits à composantes graves
(vibrations, bruits de roulement, bruits de moteurs, ventilateurs) sont
beaucoup plus gênants que les bruits à composantes aiguës.
Après ce bref aperçu sur les propriétés physiques et physiologiques du son, nous allons décrire l'appareil auditif dans son double aspect anatomique et fonctionnel.
 |  |  |  |  |  |  |  |