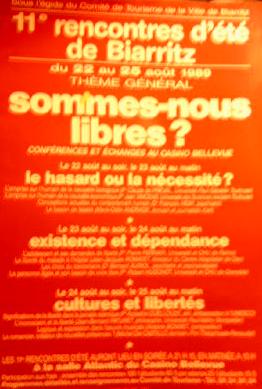LES CHOIX DU TOXICOMANE
Qu'est-ce qu'un toxicomane ? (Biarritz, 1989)
Dr Bernard Auriol
Antoine
Porot (1969) appelle toxicomanie « l'appétence anormale et prolongée
manifestée par certains sujets pour des substances toxiques ou des 'drogues'
dont ils ont connu accidentellement ou recherché volontairement l'effet sédatif,
euphoristique ou dynamique - appétence qui devient rapidement une habitude tyrannique
et entraîne presque inévitablement l'augmentation progressive des doses ».
La toxicomanie est une appétence, une forme
sophistiquée de besoin, construit autour d'effets spécifiques
du toxique. Ces effets du toxique ne sont pas étrangers au fonctionnement
de notre organisme. C'est pour cela qu'ils ne sont pas l'objet d'une
répulsion définitive et qu'ils peuvent entraîner
une puissante adhésion du sujet. Ces effets consistent à
relever et exagérer diverses étapes menant du manque à
la satisfaction.
Par exemple les opiacés procurent le soulagement
et la paix en diminuant tous les messages de souffrance, physique ou
psychique; ils le font bien au delà des besoins de l'organisme
et doivent à cette exagération leur effet "flash",
extatique, pervers. Robert Heath (1950) puis Olds, Sem Jacobson, etc..,
ont montré que notre "vieux cerveau" s'excite au plaisir
sexuel, à la prise d'opiacés, de cocaïne, de cannabis
ou à l'électricité. L'animal qui a essayé
ne s'arrête plus. Il s'agit du "système récompense"
du cerveau: tous les conditionnements en dépendent. C'est la
racine, la source qui permet tous les conditionnements, tous les apprentissages
quels qu'ils soient. Tous les supports et tous les obstacles intervenant
dans chacun de nos choix !
|
 |
Qu'est-ce que
Choisir ?
Ce terme signifie
"apercevoir" jusqu'au XVII° s. et se rapproche du latin "gustare"
et du grec "geusis", "geuô": il vient du gothique
"kiousan" qui signifie "éprouver, goûter" d'où
en anglais "to choose". En Sanskrit "djous, djousta" signifie
"se plaire à, avoir une prédilection pour, s'adonner à".
Cette étymologie rend très
parlant le titre qui m'a été suggéré: la toxicomanie
comporte d'apercevoir, d'entrer en contact puis de prendre goût à
un certain produit jusqu'à l'addiction la plus complète. C'est
un choix du plaisir, d'un certain plaisir, assez éloigné de nos
désirs essentiels, de ce mouvement profond de l'éthique dont il
nous détourne en remplissant de sable l'amphore d'or.
L'Ingénue
Liberté
ou Le Choix de devenir Toxicomane
Quincey,
Baudelaire, Artaud, Michaux, Timothy Leary (1968), et d'autres moins connus,
ont voulu faire de l'option toxicomaniaque une voie artistique, spirituelle,
non sans prétentions philosophiques...
On
a beaucoup souligné depuis l'aspect illusoire d'une telle liberté. C'est un
"choix de sophie" (Pakula, 1982): entre plusieurs dispositifs, le
sujet privilégie l'un d'entre eux plutôt que tenter leur harmonisation. Dionysos
contre Apollon.
Ces
dispositifs semblent, au plan biologique, destinés à promouvoir ou sauvegarder
la survie: état de vigilance, tolérance à la souffrance, sens de la compétition,
etc. Se droguer revient à faire passer ces moyens pour des fins. Ainsi pervertis,
plutôt qu'éloigner la mort, ils la procurent. C'est une Hérésie.
Considérons
l'être humain comme un organisme, c'est à dire un être un et pourtant
constitué d'une multiplicité de sous unités intriquées, inter connectées...
Un tel organisme dans son interaction avec ce qui l'entoure, en tous domaines,
rencontre des opportunités et des infortunes. Il agit en reproduisant ce qui
le fait subsister, s'épanouir, se développer, au moins se défendre. Ceci est
l'aspect "instinct de vie" repérable à tout instant chez tout être
vivant.
Pourtant,
le suicide, certaines attitudes inattendues nous font suspecter l'existence,
aussi de forces désorganisatrices qui semblent tendre à détruire cette vie,
briser l'unité dynamique qu'elle représentait, cultiver les conflits, les morcellements,
les destructions pour aboutir parfois à l'anéantissement...
Déjà,
la médecine, en ses hauts faits les plus glorieux, illustre le propos :
la chirurgie tranche dans le vif sous couvert d'une mort apparente, la radiographie
use de rayons ionisants pour poser un diagnostic, l'infirmière se sert d'hémorragies
contrôlées, le généraliste manie des substances tout à fait nocives si elles
n'étaient dosées, etc.
C'est
qu'on s'arroge le droit - et on en a le pouvoir - de nuire à quelque partie
pour sauvegarder le tout. La démarche toxicomaniaque semble faite du même tabac[1], même si le résultat nous attriste. Mes maîtres insistaient
parfois sur le rôle antidépresseur du champagne; chacun connaît la nécessité
désénervante de la cigarette; l'inspiration amoureuse peut parfois se tisser
de chanvre indien et la nuit interminable plonger dans le comprimé miraculeux.
Ainsi
chaque drogue développe une série d'avantages, parfois profondément
divergents, dès le premier regard, comme si on parle du café et des amphétamines
par rapport aux barbituriques ou aux tranquillisants. Cette panoplie de bienfaits
s'assortit pourtant, vous le savez, d'un ensemble d'inconvénients que les spécialistes
les plus encratiques pousseront jusqu'à la caricature alors que les plus démagogues
tenteront de les escamoter ou, à tout le moins, de les atténuer...
inconvénients
communs bien répertoriés
Dépendance,
assuétude, accoutumance, escalade posologique, inconvénient commun fondamental:
le lien à l'instinct de mort stimuler un sous système au détriment de l'unité
d'interaction mettre hors circuit une fonctionnalité ; en fait, bouleverser
la hiérarchie dynamique de l'organisme pour valoriser tel ou tel sous ensemble
de manière brutale, artificielle, partiale.
Ceci
est à bien différencier du même bouleversement, progressif ou rapide, qui se
ferait en intégrant toutes les parties concernées, c'est à dire d'une manière
solide, stable, humaine au sens que rien du système humain n'est sacrifié ou
idolâtré. C'est dire combien la démarche psychédélique (Leary) est éloignée
de toute vraie mystique, de toute évolution psychologique réelle, malgré tous
les efforts initiatiques (Castanéda). Chercher dans un produit une super-analyse
ou une néo-spiritualité est entièrement voué à l'illusion et à la gueule de
bois dans la descente des lendemains qui déchantent (Auriol, 1987).
Des
coups d'essais qui peuvent devenir maîtres
Le
choix du toxique comporte de le rencontrer et, seulement ensuite, de s'y complaire.
Le rencontrer en raison de la pression sociologique d'ensemble (tabac, alcool)
ou plus spécifique: snobisme de la cocaïne, des amphétamines, de l'héroïne,
du cannabis.
| Alcool, tabac, danger
pour la matière grise !
Troubles de l'apprentissage, de la mémoire et de la concentration...
La consommation régulière d'alcool et de tabac nuit au cerveau.
Grâce à l'IRM, un chercheur américain montre que ces
deux substances associées provoquent la perte de matière
grise !
Pour lui, les sujets alcoolo-tabagiques sont vraiment exposés
à un déclin rapide de leurs capacités de mémoire,
de compréhension, d'attention... Surtout passé 40 ans.La
combinaison des deux toxiques constitue vraiment un cocktail redoutable.
Car alcoolisme chronique et tabagisme chronique sont le plus souvent associés.
Source: Alcoholism: Clinical
and Experimental Research, February 2006
|
Il
peut s'agir aussi d'un service rendu: un ami qui vous veut du bien... le médecin
lorsqu'il s'agit de BZD (André, 1989). Le copain pour la colle...
Le
premier contact peut-être accidentel et sans choix... Généralement les suivants
sont "volontaires" ( Massengale'o, 1963) et signent la complaisance
à l'extremum entrevu... d'où n'est jamais absent le parfum de la Dame Noire.
Pour
le tabac, il s'agit de se valoriser, s'affirmer viril, ou adulte, de partager
la communauté des grands en dégradation manifeste du rite paisible du calumet
que nous transmirent les peaux-rouges (Geraud, 1967).
Le
caractère épidémique des toxicomanies, comme il appert pour le tabac, l'alcool,
la caféine via le coca cola, les BZD ou le crack doivent nous
éloigner des assertions péremptoires quant au caractère "pré-génital"
(Fenichel) du choix toxicomaniaque. Comme lorsqu'on dit que les "toxicomanes
sont incapables d'être normalement heureux", qu'ils ont un mode d'amour
égocentrique et narcissique qui va de pair avec une avidité et une soif d'absolu
de type "oral". De même, on ne peut se limiter à l'observation de
Serge Lébovici, pour qui, la compulsion toxicomaniaque repose sur un cercle
vicieux qui conduit du besoin incoercible à la culpabilité, et de la culpabilité
à la dépression, laquelle engendre à son tour le besoin.
De
fait nous assistons à une oblitération de l'Autre comme sujet de désir
Nous
sommes ici en présence de mécanismes physio-psychologiques aptes à nous faire
mesurer combien nous devons être prudent quand il s'agit d'employer le terme
de régression et de ranger un individu dans le schéma d'une structure.
L'infinie
variété des personnalités s'accommode de mécanismes communs qui nous permettent
de respirer, nous alimenter, nous vêtir, nous loger et nous reproduire. Non
seulement nous savons utiliser ces mécanismes pour en jouir, les servir par
nos représentations, les valoriser par nos investissements, mais nous pouvons
aussi détourner et pervertir leur usage, quelle que soit notre
structure inconsciente, pourvu que la pression pharmacologique et sociologique
soit suffisante.
Quitte
à remarquer que certains résistent à des pressions très fortes ou se montrent
capables de s'en libérer malgré une première assuétude.
Le Choix du
toxique
"La
drogue dans tous ses états" (Gendre, 1989)
On
pourrait s'intéresser au choix du toxique, à partir des données sociologiques
qui permettent ou non le contact entre telle population et tel type de produit;
ou encore aux données politiques, à leurs causes et à leurs conséquences économiques:
elles sont très souvent explicatives de la géographie d'une toxicomanie: les
agriculteurs défendent leurs vignes et Mendès-France trébuche sur un verre de
lait. Les interdictions politiques ont un rôle ambigu en suscitant le réflexe
consommateur des mentalités adolescentes et l'engouement pour des surprofits
peu risqués du côté de la mafia et des dealers.
C'est
la thèse, tout à fait raisonnable, de Caballero (1989). La prohibition fut un
fiasco, elle est un fiasco, elle sera un fiasco... Le système bancaire est contaminé
par le recyclage de l'argent venu de l'ombre, le coût budgétaire de la lutte
anti-drogue augmente sans cesse, la police ou la douane d'arrête pas plus de
10 % du trafic, les prisons regorgent de monde et le marché reste florissant
! Enfin le traitement différent appliqué aux produits selon qu'ils sont traditionnels
ou pas dans les pays du Nord brouille le jeu et laisse percer quelque discrimination
économique, culturelle et peut être raciale...
D'où
la théorie d'un commerce passif qui mettrait aux mains d'un monopole d'état
l'ensemble des toxiques (du tabac à l'héroïne). L'état se priverait de toute
publicité et tenterait ainsi de concilier la liberté individuelle avec la défense
sociale ...
Grave
question qu'il n'est pas de mon sujet d'approfondir... Mon propos sera plus
restreint. et se cantonnera à l'aspect individuel du choix.
Qui avec Quoi
?
Certaines
études statistiques (Smith, 1983) ont montré que la probabilité d'usage de la
marijuana ou/et des drogues "dures", augmente avec la présence des
traits de personnalité suivants:
1) tendance
à se révolter, à être "déviant" sentiment d'aliénation à l'égard du
monde des parents attitude plutôt critique à l'égard des comportements "reçus"
dans le groupe social non conservateur, non traditionaliste peu porté à la religiosité
mal organisé dans le travail ou l'étude peu persévérant, peu motivé par la réussite
sociale peu fiable, sens de la responsabilité affaibli manque de self-control
2) manquant
de bienveillance, de douceur d'attention aux autres se sentant mal estimé ou
compris par les autres goût pour l'aventure, les expériences, l'intensité du
vécu impulsivité, émotivité, pessimisme, dépression
3) extraversion
et sociabilité Ainsi distingue-t-on trois groupes de facteurs dont le mieux
représenté est le premier qui concerne un désinvestissement énergétique de l'instance
Surmoïque dans ses aspects conscients.
Le
deuxième groupe de paramètres rassemble des traits de névroticisme et d'interaction
problématique avec les pairs.
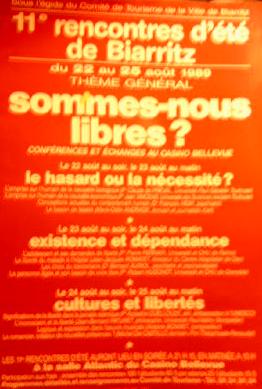 |
Le
facteur restant indique une facilité de communication qu'il faut sans
doute rapprocher de celle du psychopathe et du déséquilibré dans la nosographie
ancienne: il s'agit d'une forme de sociabilité superficielle marquée au
coin des autres traits de personnalité; elle implique une certaine composante
d'insincérité et d'utilitarisme.
Plus
qu'un rejet du Surmoi, dans le sens psychanalytique, il s'agit d'une désaffection
pour tout ce qui est autorité des autres sur soi, de soi sur les autres
et de soi sur soi: la fonction timonière de la personnalité est restreinte
ou plutôt dévalorisée, divisée en elle même, se condamnant en tant qu'instance
de direction, de condamnation, de jugement, d'unification. Apollon terrassé
par Dionysos.
Le
Sur-Moi reste égal à lui-même quant aux représentations qui lui sont liées,
il intervient chaque fois qu'il le doit, mais les résistances qu'il a
à affronter et l'énergie dont il dispose sont modifiés; ce remaniement
peut aller jusqu'à renforcer, de manière auto-punitive, l'asservissement
qu'il condamne pourtant.
La
satisfaction produite par la drogue est liée à une faute éthico-logique
et éthologique : on prend la partie pour le tout et on utilise un médium
capable de déséquilibrer l'ensemble au profit de cette partie. Le bonheur
visé, d'un prix trop élevé, cède la place à un plaisir de solde, qui montre
sa force à dérober les valeurs et qu'on acquiert, plus cher qu'il ne vaut,
par une kyrielle de traites.
|
Prendre
la partie pour le tout signifie, lorsqu'on change de partie, que les effets
se modifient; le choix du toxique conditionne ce qui sera exalté et ce qui sera
écarté; l'usager étant non seulement une victime, mais avant tout une victime
consentante ! A quoi consent-il ? Quelle est sa forme d'idolâtrie hédonistique
?
L'apologue
des trois voyageurs
est très éclairant dans sa simplicité: ils arrivèrent tous trois aux portes
de la ville qu'ils trouvèrent fermées car il était tard.
- Le
premier insulte le gardien et veut casser la porte,
- Le
deuxième propose de dormir tranquillement à la belle étoile et
- Le
troisième ne voit pas pourquoi tant de palabres alors qu'il suffit de passer
par le trou de la serrure
Vous
les avez reconnus : l'alcoolique, l'opiomane et le haschischin.
- L'alcoolique
se manifeste comme fort, ou se désole de son néant
-
L'opiomane
comme invulnérable
- Le
dibenzodiazépinomane comme serein
- Le
fumeur comme viril
- Le
haschischin comme imaginatif et fusionnel
- L'utilisateur
d'amphétamines comme infatigable
1) L'alcoolique
se manifeste comme FORT et le sentiment d'incertitude quant à sa propre force,
quant à son impact social, quant à sa virilité sont autant de faiblesses.
2) L'opium
entraîne une forme de dépression, surtout respiratoire. Il est
à la base d'une certaine convivialité. Son rôle destructeur est connu et fumer
comporte une composante masochiste...
3) L'usager
de la colle, du trichloréthylène ou de l'éther donnent généralement le spectacle
d'une dépression rampante; on observe aussi des réactions de type passif-agressif,
des tendances suicidaires, des impulsions agressives ou sexuelles. Comme dans
d'autres difficultés du jeune, on remarque l'absence d'une figure masculine
forte dans la famille.
4) Le
haschisch et les autres psychodysleptiques (comme la psilocybine, le LSD, l'ayahuasca,
etc.) sont un viatique et un support pour toutes sortes de voyages intérieurs
empreints de mystique ou d'érotisme: il y a découverte de lieux cachés de l'imaginaire,
de sensations révolues, de communications inusitées, la fréquentation de la
mort ou la recherche d'un sens à la vie.
5) L'utilisateur
de tranquillisants, sous l'action de son médicament, se montrera serein à l'inverse
de ce que nous verrons à propos des amphétamines. Cette opposition étant mise
à profit - si l'on peut dire - par certains auto ou hétéro prescripteurs pour
apaiser le soir un système nerveux qu'on a galvanisé le matin ! Serein certes
et même peu concerné au point de se rendre réfractaire aux enseignements de
l'expérience (jusqu'à l'amnésie) et non impliqué dans les soucis de l'avenir
(jusqu'à l'indifférence). La recherche de la tranquillité, du cocon maternel,
du holding et du nursing semblent donc à l'origine de l'appétence pour ces produits
dont on sait que la France est hyper consommatrice.
6) La
personne qui attache une grande importance à une sensation de puissance physique,
à un état de grande vigilance, de contrôle mental et de décision rapide recherchera
les psychotoniques du type caféine, cocaïne, amphétamines . Sous l'effet de
ces drogues, en effet, il se montre infatigable, toujours en éveil, plein de
curiosité, insensible à la faim, se sentant parfaitement compétent en tous domaines.
Les perceptions sont accrues, le raisonnement accéléré. Ici, comme ailleurs
- et contre l'opinion de Jouvet - toute insensibilité à la fatigue est un avantage
à crédit: le signal invitant au repos disparaît alors que le BESOIN de repos
demeure ou même augmente; à terme on peut détériorer certains fonctionnements
et même aboutir à la mort et d'autant plus que les inter actions auront été
grandes. Ainsi ces produits favorisent en quantité, en intensité et en durée
les relations avec l'environnement mais font oublier les limites utiles (nourriture,
sommeil). Il s'agit d'une élimination provisoire des racines qui est recherché
surtout par les individus refusant le plaisir de l'enfant dans les bras de sa
mère: enfant qui se laisse bercer et endormir après avoir tété. Privilège absolu
des comportements exploratoires, plaisir du mouvement, de l'excitation au détriment
de la tranquille jouissance. La pathologie mentale exagère parfois le déséquilibre
sous forme d'agitation maniaque, exaltation, excitation, insomnie; parfois c'est
l'anxiété panique et lors du sevrage ou du manque: décompensation dépressive.
S'amphétaminer revient à se donner des coups de pied dans le fondement afin
de fuir le giron de douce quiétude dont on se sent esclave.
La
nouvelle cuisine
Un
N° d'Esprit suggère une évolution des mentalités à propos de la drogue, entre
les années 70 et celles que nous vivons. La montée du chômage, le durcissement
de la compétition, l'imitation de la Voie Japonaise dans les entreprises demande
à l'individu de se montrer enthousiaste de ce qui l'indiffère, amoureux de son
entreprise, terrorisé de perdre son emploi...
Il
use alors de tous moyens disponibles pour se sentir d'attaque, le meilleur,
branché, câblé, dans la course... Et se fait Janus pour cela : "profil
'training', profil 'cocoon'" : Se jeter dans le vide au bout d'un élastique
puis faire du yoga, ou plutôt - plus aisé - se gaver le matin d'excitants, et
de tranquillisants le soir..
"C'est
de l'individu sous perfusion dans une société en train de se doper"
(Ehrenberg, 1989) qu'il s'agit, "parce qu'une culture de la conquête
est nécessairement une culture de l'anxiété qui en est la face d'ombre"
(idem).
Voici
venir les "drogues d'intégration sociale", choix pour la Société
et non refus de ses contraintes.
Les
pionniers en ce domaine sont les héros qu'on a voulu proposer aux jeunes: les
sportifs du baron de Coubertin. Un idéal tant qu'ils ne se font pas prendre;
est-il vrai qu'ils se dopent tous ? Aux drogues de tous ou avec leurs poisons
spécifiques, tels les anabolisants... Ils les choisiraient, même mortels, pour
avoir le succès sans être dépistés... Charlie Francis, l'entraîneur de Ben Johnson,
déclare avoir placé son poulain "devant ses responsabilités. Ben devait
décider. S'il choisissait de s'abstenir de consommer des stéroïdes, il s'infligeait
un handicap d'un mètre par rapport aux autres, au départ des courses"
(Le Monde, 4 Mars 1989).
Succès
à la bouche : l'ecstasy est au goût du jour, elle fait les gorges chaudes des
salons et se conditionne dans une usine de médicaments. Est-ce bien un crime
? Sauf qu'elle est tout aussi dangereuse à terme que les autres excitants et
tient moins que son nom ne promet...
Le Choix d'abandonner
ou de Changer de Toxicomanie
Est
parfois venu de l'extérieur dont l'agression se solde bien souvent par l'échec.
A moins qu'une atmosphère, un guru ou un personnage charismatique n'entraÎne
une adhésion plus intérieure. La difficulté majeure est que "le toxicomane
ne souffre pas de son mal, il en jouit" (Rado, 1933).
Nous
ne pouvons refuser au drogué le pouvoir de choisir de ne plus l'être. Ce pouvoir
semble pourtant parfois très réduit, limité. L'asservissement semble disqualifier
l'intérêt d'un autre choix, magnifier la satisfaction immédiate de l'artificiel
besoin; après, que vienne le déluge ! Comme il advint de Noë, l'inventeur biblique
de l'ivresse (mais lui ne but qu'après !...) (Genèse, IX, 20-27).
Se
faire l'esclave de Dionysos ou du Divin Marquis n'est pas de tout repos, moins
encore si la divinité se réduit à la misérable effigie d'une seringue, d'une
bouteille, d'une paille ou d'un calumet.
Sandor
Rado ne voit que trois issues possibles :
-
le
suicide
-
le
refuge dans la psychose
-
la
cure de désintoxication
On
a tout essayé - ou beaucoup : déconditionnement par chocs électriques (Anonyme,
1970), relaxation (Cordeiro, 1971), yoga (Liné-Guillermin), chimiothérapie,
acupuncture, homéopathie, psychothérapies analytiques ou psychanalyse (Rado,
1933), sociothérapies, apport alimentaire massif (sucre) (Lévy, 1989), désintoxication
par courants de Limoge (Daulouède, 1980), etc.
Tous
ces moyens donnent quelques résultats, surtout dans l'enthousiasme des débuts
ou lorsque le désir de guérir est très important et soutient
puissamment l'effort du sujet et de ses thérapeutes.
Lorsque
le sevrage est acquis, on est, très souvent, en présence d'une personnalité
manquant de consistance, insatisfaite, totalement dépendante auprès de laquelle
doit se trouver un objet complémentaire substitutif de la drogue (Delteil, 1971).
Je
tiens depuis longtemps - et beaucoup de voix convergent pour asseoir mon sentiment
(Nahas, 1982) - que la psychanalyse orthodoxe rigoureuse n'est pas une voie
praticable pour permettre une libération du toxique: elle ne retrouve ses lettres
de créance qu'au sortir du tunnel; lorsque l'abandon du toxique est acquis ou
très prés de l'être. Et encore ! Il arrive que les chiens retournent à leur
vomissure ... Ils seront relapse plutôt que d'affronter certaines prises de
conscience, résistance majeure, chausse trappe redoutable.
C'est
dire combien le psychanalyste se devra d'éviter toute accélération intempestive
de la démarche, quitte à résister, lui-même, parfois ! Sous la pression des
comportements, on suggère un glissement progressif de la disponibilité à la
rythmicité en fonction de la "maturation du moi" et de ses défenses
(Geadah, 1982).
Un
ami thérapeute me faisait remarquer, il y a quelques jours, combien sont proches
certaines expériences rencontrées dans diverses formes de thérapie (plus spécialement,
celles qui doivent quelque inspiration à Reich, à la Catharsis, au potentiel
humain, à l'énergétique, etc.) et les expériences liées à la drogue: sentiments
d'élation, de puissance, de fusion, d'abolition des limites, de dépersonnalisation,
de planer, d'être plein d'énergie, etc. Cette similitude de vécu peut être un
encouragement permettant au toxicomane d'entrevoir qu'il peut trouver ailleurs
que dans la chimie ce qu'il y cherchait. Au prix sans doute de plus d'efforts,
de variabilité des effets, de non reproductibilité.... Une liberté accrue, une
véritable libération en étant la récompense.
Depuis
les années 70, on sait combien les groupes spirituels, méditatifs, charismatiques,
mystiques, de dévotion peuvent être efficaces pour offrir une ouverture sur
la vie au drogué qui s'y donne. Non seulement en raison des techniques proposées
(méditation, prière), mais aussi grâce au support, voire aux contraintes de
la secte, de l'Eglise, du parti ou du groupe, en général.
Certains
spécialistes dénoncent la "nouvelle dépendance" qui en résulte et
vont jusqu'à prétendre qu'il "vaut mieux dépendre de l'héroïne que du Patriarche".
Il n'est pas question, pour moi, d'encenser une chapelle plus qu'une autre,
je ne peux pourtant adhérer à une telle condamnation qui ne laisse aucune chance
à ces méthodes non conventionnelles mais salvatrices... Les intervenants dans
la thérapie des toxicomanes se sont, jusqu'à ce jour, montrés peu coopératifs,
nourrissant facilement des rancœurs mal avouables, cherchant à être seuls
en lice dans une arène où ils sont mal assurés de pourfendre leur véritable
adversaire... Notre compétition serait elle à la mesure de notre incompétence
?... Cette compétition est plus souvent celle de factions, d'équipes que d'individus.
Personnellement
je pense que la confusion dans les choix liée à l'usage de la drogue, aux intérêts
énormes qu'elle met en jeu (cf. le Cartel de Medellin, dont on parle un peu;
Le Monde du 20-21 Août 1989, p.1), et à la nouveauté que représente l'extension
du fléau, son lien au Sida ne pourra se clarifier sans un choix clair des responsables
politiques, des thérapeutes et de l'opinion dans son ensemble: choix en faveur
de satisfactions plus humaines que le simple goût de posséder, d'exercer un
pouvoir, de réussir, de tenir, d'exister.
"Etre
ou ne pas être", comme a dit quelqu'un....
BIBLIOGRAPHIE
André
J. Usage dévié des médicaments et surconsommation médicamenteuse, Bulletin de
l'ordre départemental des Médecins de la HG, pp. 21-22 Juin 89
Anonyme
Comment s'arrêter de fumer, Rec. pér. E.M.C., Intox., 54, I, 16991 P.60, Juil
1970
Auriol
B. Qui avec Quoi ?, Communication invitée au Congrès sur la Toxicomanie, La
Plaine Sur Mer - 7 et 8 Novembre 1985
Auriol
B. La démarche mystique est-elle addictive ?, (Point de vue introspectif et
physiologique), ARPPMMP - 12 Décembre 1987
Baudelaire
Ch., Paradis artificiels: Du vin et du hachisch, Les paradis artificiels : Le
poème du hachisch. ; Un mangeur d'Opium (Exorde et notes pour les conférences
données à Bruxelles en 1864); in Oeuvres
complÈtes T.1 - La Pléiade, Gallimard
Caballero
F. Droit de la Drogue, Précis Dalloz, 1989
Cordeiro
J.C. Une nouvelle perspective dans le traitement des toxicomanes, la relaxation,
Ann. Méd. Psy. 130, 1, 1, 11-17, 1971
Daulouède
J.P. et coll. Une nouvelle méthode de sevrage des toxicomanes par utilisation
du courant de Limoge (à propos de 11 cas), Annales Médico-Psychologiques, 138,
359-369, 1980
Delteil
P. Etude psychanalytique des toxicomanies, Inform. Psychiat. 47, 7, 619-624,
1971
Denis-Lempereur
J. Les Français camés aux benzodiazépines", Science et Vie, 38, 30-43,
1989
Ehrenberg
A. L'individu sous perfusion, Esprit, 152-153, pp. 36-48, Juillet - Août 1989
Fatéla
J. Des battants déchus, Esprit, 152-153, pp. 49-55, Juillet - Août 1989
Geadah
R. Réflexions sur les effets pharmacogéniques et les implications thérapeutiques
de l'intoxication chez des mères isolées et démunies, Psychologie Médicale,
14, 12, 1847-1853, 1982
Geraud
R. Pourquoi fumez-vous ?, Concours Médical 89, 52, 9022-9024, 30 Déc. 1967
Jaubert A. d... comme drogue, Alain Moreau
éditeur, 1973
Leary
T. Politique de l'extase, Fayard ed., 1973
Le
Gendre La drogue dans tous ses états, Le Monde, p.8, 20-21 Août 1989
Le
Pen C. L'économie politique des tranquillisants, Esprit, 152-153, pp. 29-35,
Juillet - Août 1989
Lévy
S. Du sucre pour les sujets en manque, Impact Méd 3 Juin 1989, p. 40
Lévy
S. Traitement : les toxicomanies (Rôle des médicaments), C.R. des J. d'Etude
du CNPERT, Impact Méd., 24 6 89 pp44-45
Massengale'o
et coll. Les facteurs physiques et psychologiques dans les cas d'inhalation
volontaire de vapeur de colle, The New England J. of Medicine, 269, 25, 19 Déc
1963
Meyer
P. La révolution des médicaments, Fayard, 1984
Mignon
P. Les nouvelles drogues psychédéliques, ou le bonheur chimique, Esprit, 152-153,
pp. 56-63, Juillet - Août 1989
Nahas
G. Toxicomanie : des points de convergence, Revue de Médecine de Toulouse, 586,
1982
Nin Anaïs, Delta of Vénus Erotica, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1977,
(traduction
française par B. Commengé, 1978)
Pakula
A.J. Le Choix de Sophie, (film)
Porot
A. Manuel Alphabétique de Psychiatrie, PUF - 1969
Rado S. The psychanalysis of Pharmacothymie, Psycho. Analyt. 2, 1, 1933
Simon
P. et Colonna L. Mieux connaître et mieux prescrire les psychotropes, PIL éditeur
- 2° Ed. 1979
Smith G.M.
Les effets perçus de l'usage d'un psychotrope : une théorie générale,
Psychotropes 1 - 1 - 1983 pp.85-91
Vigarello
G. Quand l'opium n'était pas une drogue, Esprit, 152-153, pp. 64-67, Juillet
- Août 1989
Filmographie
abrégée sur la Toxicomanie :
Cocteau
J. Le sang d'un poète (1930)
Decoin
H. Razzia sur la chnouf (1956)
Forman M. Taking Off (1970)
Hagman
S. Des fraises et du sang (1969)
Hopper D. Easy Rider
Mankievicz
J. Le Château du Dragon (1946)
Morrisey P. Trash (1970)
Preminger
O. L'Homme au bras d'or (1955)
Rafelson
B. La Veuve noire (1987)
Sautet
C. Un mauvais fils (1980)
Schatzberg J. Panique à Needle Park (1971)
Schroeder B. More (1969)
Stone O. Platoon (1987)
Zinnemann
F. Une poignée de neige (1957)
Zugsmith
A. Les Confessions d'un mangeur d'opium (1962)

©
Copyright Bernard AURIOL (email :
auriol@free.fr
)
22
Janvier 2007