État des lieux des connaissances actuelles sur la notion de latéralité auditive
{Chapitre 3 : L’apport du découpage IDS dans la compréhension des aspects qualitatifs de la perception auditive et du contrôle de la boucle audio-phonatoire, Mémoire de fin d'Etudes soutenu par Charlie Sénécaut à l'École Nationale Supérieure Louis-Lumière, Section Son, rédigé sous la direction de Bernard AURIOL et Laurent MILLOT}
Dans ce chapitre sera introduit l’état de la recherche des dernières décennies sur la latéralité auditive. Les progrès qui ont été faits dans ce domaine le doivent à la neuropsychologie, discipline qui nous éclaire sur le fonctionnement du cerveau. En effet, si les organes sensoriels jouent un rôle de capteurs de l’information, l’interprétation de cette dernière est attribuée au cortex cérébral.
Au cours de mes recherches sur la latéralité auditive et la perception de la parole, j’ai donc été très rapidement amené à parcourir certains ouvrages traitant de la spécialisation cérébrale, et qui m’ont aidé à comprendre un peu mieux les rouages du traitement de la parole.
La latéralité auditive s’inscrit, en effet, dans un cadre plus large qui est celui de la latéralité cérébrale. Ceci n’est en rien étonnant puisque le système auditif, nous l’avons vu dans le premier chapitre, va du pavillon de l’oreille jusqu’aux aires auditives situées dans les hémisphères gauche et droit du cerveau.
Tomatis, que nous avons introduit dans le chapitre précédent, s’appuyait justement, pour étayer ses propos sur l’oreille directrice droite, sur une théorie impliquant l’hémisphère cérébral gauche dans le contrôle du langage.
| |
Nous proposons donc, dans ce chapitre, de faire le point sur cette théorie attribuant à l’hémisphère gauche, l’exclusivité du traitement de la parole.
1. Les différentes techniques utilisées pour appréhender la latéralité auditive
1.1. Introduction
Les découvertes concernant les spécialisations hémisphériques ont connu plusieurs phases, chacune caractérisée par les moyens techniques dont disposaient les chercheurs. On peut les regrouper comme suit :
- Les études effectuées sur des individus victimes de lésions cérébrales. Celles-ci pouvant soit être localisées dans une région d’un hémisphère, soit occuper l’hémisphère dans sa totalité. Il est alors possible de faire correspondre une aphasie avec une région ou la totalité d’un des deux hémisphères lésée ;
- Les études faîtes sur des sujets épileptiques avant ou après opération. Dans le premier cas, on utilise un produit permettant d’anesthésier temporairement un seul hémisphère et de déterminer ainsi le côté qui contrôle normalement l’expression orale. Dans le second cas, l’opération correspondant à l’ablation des connexions inter-hémisphériques (entre les deux hémisphères), on peut étudier le cerveau droit isolé du cerveau gauche et inversement ;
- Les études effectuées sur des sujets sains. Ces dernières peuvent se subdiviser en deux classes : les tests utilisant les technologies de d’imagerie cérébrale telles l’imagerie à résonance magnétique (IRM) ou la tomographie à émission de positons (TEP) qui permettent d’observer l’activité du cerveau en réponse à certains stimuli ; et les tests comportementaux telle l’écoute dichotique que nous utiliserons dans ce mémoire.
1.2. L’apport des lésions cérébrales
L’origine des travaux sur la latéralité du langage remonte à Paul Broca, chirurgien français qui, en 1861, localise la région impliquée dans la production du langage articulé en procédant à l’autopsie d’un de ses patients.
Celui-ci, juste avant sa mort, ne pouvait prononcer d’autres syllabes que « tan », bien qu’il comprenait ce qu’on lui disait. Sans être atteint d’aucun trouble moteur de la langue ou de la bouche qui aurait pu affecter son langage, ce patient ne pouvait produire aucune phrase complète ni exprimer ses idées par écrit.
En observant le cerveau de ce patient défunt, Paul Broca découvrit une lésion située à un endroit précis de l’hémisphère cérébral gauche, au niveau de la troisième circonvolution du lobe frontal. C’est en retrouvant à plusieurs reprises des lésions au même endroit du cerveau, chez d’autres patients atteints d’aphasie [1] , que Broca pensa avoir découvert la région cérébrale responsable du langage. Le patient victime d’une lésion à cet endroit perdra ses capacité à produire du langage. Cette aire du cerveau est aujourd’hui connu sous le nom d’“aire de Broca“ et le trouble correspondant à sa lésion est appelé “aphasie de Broca“.
Ce chirurgien qui connaît bien les corrélations entre lésions d’un hémisphère (le gauche par exemple) et la paralysie de la partie du corps opposé (de ce fait, la droite) est convaincu qu’il en est de même pour le langage. En effet, puisque les patients droitiers atteints d’aphasie ont leur hémisphère droit intacte, Broca est persuadé qu’il existe un lien entre la latéralité motrice et la latéralité du langage. Il formule ainsi la règle qui porte son nom :
« l’hémisphère contrôlant la parole est du côté opposé à la main préférée ».
Ainsi, est posée la première pierre de l’édifice que nous construirons pour montrer que le langage n’est pas universellement l’apanage du cerveau gauche comme Tomatis le laisserait entendre. En parlant des gauchers, dans un bulletin de la Société anthropologique paru en 1865, on peut lire :
« On conçoit qu’il puisse y avoir un certain nombre d’individus chez lesquels la prééminence native des circonvolutions de l’hémisphère droite renversera l’ordre des phénomènes que je viens d’indiquer. [2] »
En 1874, Carl Wernicke, neurologue et psychiatre allemand d’origine polonaise, fit la découverte d’une région située dans le lobe temporal de l’hémisphère gauche et dont la lésion entraîne la perte ou le trouble de la compréhension du langage parlé. Les patients atteints d’une aphasie de Wernicke peuvent parler, mais leur discours est souvent incohérent et dénué de sens.
Ces deux découvertes fondamentales dans l’histoire de la latéralité cérébrale allèrent toutes deux dans le sens d’une spécialisation de l’hémisphère gauche, pour les droitiers, tant dans la compréhension que dans la production du langage articulé. Il fallu attendre plus d’un demi-siècle pour que d’autres découvertes scientifiques apportent leurs contributions et rendent le problème de la latéralité plus complexe que ne l’envisageaient Paul Broca et Carl Wernicke.
1.3. L’apport des études effectuées sur des sujets épileptiques
a) La commissurotomie : séparation chirurgicale des hémisphères
Depuis les découvertes de Broca et Wernicke sur la spécialisation de l’hémisphère gauche pour le langage, de nombreuses études ont été faites sur des patients victimes de lésions cérébrales les privant de leur hémisphère gauche.
Les capacités langagières de l’hémisphère droit sont donc étudiées et montrent en effet qu’une lésion cérébrale gauche entraîne dans la majorité des cas sinon la perte, du moins des troubles du langage. Cependant, quelques exceptions figurent à la règle de Broca [3] montrant que ces troubles du langage peuvent affecter des gauchers et laisser indemnes des droitiers. Ces exceptions portent le nom d’“aphasiques croisés“.
Une autre façon d’étudier le rôle de chaque hémisphère séparément, sans que l’un des deux soit lésé, consiste à supprimer certaines des fibres nerveuses reliant des régions du cerveau gauche à des aires similaires du cerveau droit (la totalité de ces fibres forment le “corps calleux“). Cette opération du cerveau dédoublé, ou commissurotomie, est pratiquée chez des sujets épileptiques dont les crises sont provoquées par des décharges entre les deux hémisphères.
Dans l’ouvrage Cerveau gauche, cerveau droit de Springer et Deutsch, on peut lire :
« Eran Zaidel fut le premier à entreprendre une recherche systématique du langage de l’hémisphère droit chez des patients à cerveau dédoublé.
La stratégie de Zaidel consiste à tester la capacité de chaque hémisphère en utilisant une variété de stimuli qui avaient été préalablement utilisés chez des enfants ou des patients aphasiques. Son but était d’obtenir des données susceptibles de permettre des comparaisons entre les capacités de l’hémisphère droit des patients au cerveau dédoublé et celles des deux autres groupes.
Les premiers tests de compétence grammaticale de Zaidel l’ont amené à la conclusion que l’hémisphère droit possède une compétence équivalente à celle d’un enfant de cinq ans. [4] »
Nous voyons là une seconde donnée incitant à la prudence quant à l’affirmation que le langage est l’objet d’un traitement exclusif du cerveau gauche pour les droitiers. Plus loin, Zaidel ajoute d’ailleurs qu’en étudiant le traitement du langage chez des aphasiques ou des cerveaux dédoublés on sous-estime le rôle de l’hémisphère droit dans les compétences langagières. Selon lui, en présence de l’hémisphère gauche et grâce au corps calleux, l’hémisphère droit devrait participer de façon plus active au traitement de langage [5] .
b) Le test de Wada : anesthésier un hémisphère
Le test de Wada, d’après le nom de son inventeur, Juhn Wada, est très précieux pour distinguer les fonctions de chaque hémisphère. Il consiste à injecter dans l’artère amenant le sang à l’un des deux hémisphères cérébraux, un produit appelé « amobarbital sodium » qui anesthésie temporairement et uniquement cet hémisphère.
Cette anesthésie est régulièrement effectuée sur les sujets atteints d’épilepsie avant de les opérer. Il permet de déterminer le côté qui contrôle normalement l’expression orale.
D’après la plus grande étude de ce type publiée en 1977 [6] , le langage est contrôlé par l’hémisphère gauche chez plus de 95 % des droitiers sans lésion cérébrale précoce ; chez les autres, c’est l’hémisphère droit.
Contrairement à la règle de Broca, c’est aussi l’hémisphère gauche qui contrôle la parole chez une majorité de gauchers, dans une proportion cependant plus faible que chez les droitiers, à hauteur de 70 %. On observe ainsi que, sur les 30 % restant, le langage est contrôlé par l’hémisphère droit chez 15 % des gauchers, alors que les 15 % restant montrent des signes évidents de contrôle de la parole par les deux hémisphères (contrôle bilatéral du langage).
Chez les patients qui avaient subi des lésions précoces de l’hémisphère gauche, cette étude de 1977 montre une plus forte fréquence du contrôle bilatéral de la parole, ainsi que du contrôle par l’hémisphère droit : 70 % des gauchers et 19 % des droitiers se trouvaient dans l’une de ces deux catégories [7] .
Ces travaux montrent les limites de la manualité (ou latéralité manuelle) comme indice de spécialisation hémisphérique pour le langage rendant le problème plus complexe encore.
Il montre également la notion de plasticité cérébrale qui signifie que le cerveau peut dans les premiers instant de la vie, s’adapter de manière surprenante à des contraintes telles que les lésions cérébrales [8] .
1.4. Exploration de la dissymétrie du cerveau normal
a) Un test comportemental : l’écoute dichotique
Nous estimons important de décrire avec précision ce test que nous utiliserons dans une forme différente mais comportant des problématiques communes. Nous nous sommes pour cela beaucoup aidé de l’ouvrage Cerveau gauche, cerveau droit, dont on trouvera les références complètes en bibliographie.
De même que la présentation en hémichamps visuels permet d’utiliser des stimuli visuels pour étudier la dissymétrie, une autre procédure, l’écoute dichotique, permet d’étudier les différences et les similitudes dans la façon dont les deux hémisphères manipulent la parole et d’autres types d’information auditive.
Avec cette technique, les sujets entendent des paires de stimuli : un stimulus à chaque oreille simultanément. C’est la psychologue Doreen Kimura, de l’Université d’Ontario-Ouest, qui, la première, démontre que, dans les conditions d’écoute dichotique, les sujets normaux répètent les mots présentés à l’oreille droite avec plus d’exactitude que les mots présentés à l’oreille gauche ; elle imagine alors un modèle afin d’expliquer une telle dissymétrie :
« Contrairement à la rétine qui envoie des projections controlatérales d’une moitié de sa surface, et des projections ipsilatérales de l’autre moitié, chaque oreille envoie de l’information aux deux hémisphères. D’une oreille donnée, les fibres ipsilatérales projettent sur l’hémisphère du même côté et les fibres controlatérales projettent sur l’hémisphère du côté opposé. Ainsi, l’information complète sur un stimulus présenté à une oreille est représentée initialement sur les deux hémisphères ; chaque oreille réussit aussi bien lorsqu’elle est testée seule. [9] »
Dans l’ouvrage Cerveau gauche, cerveau droit, on lit :
« Kimura se réfère à des données physiologiques montrant que les voies ipsilatérales sont plus faibles, moins nombreuses et ont une vitesse de conduction plus lente que les fibres controlatérales. Selon les proportions de cet auteur, lorsque deux items sont présentés simultanément, un à chaque oreille, la voie de chaque oreille à l’hémisphère ipsilatéral est inhibée ou supprimée ; en conséquence, l’information présentée à chaque oreille projette d’abord ou exclusivement sur l’hémisphère controlatéral. [10] »
Plus loin, Springer et Deutsch nous expliquent que le test d’écoute dichotique a été utilisé également chez des individus au cerveau dédoublé. Les résultats confirment ceux obtenus avec des sujets normaux. On assiste même à une exagération du procédé, le sujet au cerveau dédoublé ne percevant que le mot reçu par l’oreille droite.
Cela montre à la fois la dominance de l’hémisphère gauche pour le langage, et la dominance de la voie controlatérale conduisant l’information sonore au cerveau du côté opposé de l’organe auditif.
Les résultats du test dichotique sous-estiment le nombre de droitiers ayant leur hémisphère gauche spécialisé dans le langage. Ces résultats sont de 80 % contre 95 % avec le test de Wada décrit plus haut.
Les auteurs de Cerveau gauche, cerveau droit proposent une raison à cela. Ils mettent en avant l’importance de la stratégie adoptée par le sujet qui décide ou non de jouer le jeu. Rien n’empêche, en effet, celui-ci de se concentrer sur ce que reçoit l’une des deux oreilles en faussant ainsi l’épreuve.
Plus loin, il sera fait référence à la difficulté d’interpréter les scores de l’épreuve dichotique, indépendamment de la stratégie adoptée par le sujet. En effet chaque auteur semble avoir sa méthode et le cahier des charges semble avoir autant de versions différente qu’il existe d’examinateurs.
Enfin notons que ces tests ont également été utilisés avec des stimuli musicaux montrant une prédominance de l’hémisphère droit (donc par l’intermédiaire de l’oreille gauche). Mais ce phénomène semble s’inverser pour des musiciens professionnels.
b) Les techniques d’imagerie cérébrale
Le développement récent des techniques d’imagerie fonctionnelle cérébrale permet de porter un regard nouveau sur la psycho-acoustique de l’entendant. Elles permettent d’étudier chez l’homme vivant et de façon atraumatique le traitement central de l’information sonore.
Une description d’une de ces techniques, la TEP, est présentée dans l’ouvrage de Jean Abitbol, L’oreille musicienne, que nous réutiliserons ici :
« La tomographie par émission de positons (TEP) ou PETscan (Positon Emission Tomography) objective au niveau d’un organe quelconque l’augmentation locale de l’apport en oxygène et les variations de certains neuromédiateurs. Il consiste à injecter des marqueurs radioactifs spécifiques, de durée très brève, dont on observe l’effet sur la plaque photographique des coupes radiographiques du scanner cérébral effectué immédiatement après, pendant que se déroulent les tests auditifs. Le Petscan sert aussi à déceler les métastases de certains cancers profonds. [11] »
Plus récemment, l’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique permet la localisation des zones cérébrales activées en se basant sur l’effet BOLD (Blood Oxygen Level Dependant), lié à l’aimantation de l’hémoglobine contenue dans les globules rouges du sang. Cette application a permis de montrer que les paramètres élémentaires constitutifs des sons ne sont pas traités exactement par les mêmes structures cérébrales.
2. LES DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES SUR LA SPÉCIALISATION HÉMISPHÉRIQUE
2.1. Introduction
Les travaux des trois dernières décennies portant sur l’asymétrie cérébrale partagent une certaine prudence quant à leurs conclusions. Aucun modèle proposé ne semble en effet être en mesure de réunir tous les scientifiques travaillant dans ce domaine. Les hypothèses actuelles tentent de se situer dans un état intermédiaire entre deux représentations extrêmes, issues de la fin du XIXe siècle pouvant être grossièrement définies comme suit : un modèle « dichotomique » attribuant à chaque hémisphère le traitement exclusif de certaines tâches ; et un modèle « anarchique » selon lequel chaque traitement d’une tâche sollicite les deux hémisphères dans des zones qui peuvent être symétriques ou non.
Après une revue des théories portant sur l’origine de la spécialisation hémisphérique en ce qui concerne la compréhension et la production du langage en mettant l’accent sur celles qui nous ont semblé être les moins courantes, le lecteur désireux d’en savoir plus pouvant facilement trouver les hypothèses les plus en vogue, nous nous intéresserons aux modèles expliquant le traitement des sons de la parole chère à notre étude.
2.2. Hypothèses sur l’origine de la latéralité du langage
a) État des lieux succinct
On trouve de nombreuses théories dans la littérature expliquant l’origine de la spécialisation hémisphérique pour le langage et conférant celle-ci à l’hémisphère gauche. Dans l’ouvrage Cerveau et Langage, les auteurs, Olivier ETARD et Nathalie TZOURIO-MAZOYER, passent en revue les théories qui, d’après eux, sont les plus influentes. Nous les résumons ici brièvement, renvoyant le lecteur à cet ouvrage pour de plus amples détails.
Outre les modèles génétiques (attribuant l’origine de la spécialisation de l’hémisphère gauche pour le langage à un gène), on rencontre des théories faisant intervenir les facteurs hormonaux lors du développement du fœtus et expliquant une moindre spécialisation du cerveau gauche pour le langage liée à un taux important de testostérone chez le futur bébé. Ce modèle apporterait une explication au fait qu’il existe plus de gauchers chez les hommes que chez les femmes.
D’autres modèles sont basés sur l’influence du volume cérébral dans la mise en place de la spécialisation hémisphérique. Des observations ont été faîtes selon lesquelles les cerveaux de taille importante (généralement les hommes) auraient, en proportion, un corps calleux plus petit privilégiant ainsi les liaisons intrahémisphériques (au sein d’un même hémisphère) aux liaisons interhémisphériques (entre les deux hémisphères) et reflétant ainsi une spécialisation plus marquée. Ce qui impliquerait que les femmes (au cerveau généralement plus petit) sont moins latéralisées que les hommes.
Enfin, nous sont présentés les modèles liés à la vitesse de conduction de l’information et comparant le ratio de matière grise/matière blanche [12] ainsi que le degré de myélinisation des axones entre cerveau gauche et cerveau droit. Des recherches effectuées dans ce sens montreraient une asymétrie de la substance blanche située sous le cortex auditif primaire en faveur de l’hémisphère gauche ainsi qu’une plus grande myélinisation des axones situés sous le cortex auditif associatif du planum temporal dans ce même hémisphère gauche. Ainsi, le cortex auditif gauche serait mieux équipé pour recevoir ou transférer rapidement l’information, donc pour l’analyser plus rapidement. Cette conduction plus rapide de l’information serait particulièrement importante pour l’analyse de certains sons du langage caractérisés par des variations temporelles rapides. L’un de ces modèles propose que le cortex auditif gauche serait spécialisé dans l’analyse temporelle alors que son homologue droit serait spécialisé dans l’analyse spectrale.
b) La spécialisation de l’hémisphère gauche pour le contrôle des musculatures orales et manuelles
Nous nous permettons une fois de plus d’emprunter aux auteurs de l’ouvrage Cerveau gauche, cerveau droit, l’exposition que nous trouvons particulièrement claire de cette hypothèse. Ainsi, à la page 336, on peut lire :
« Doreen Kimura et ses collègues ont observé des faits laissant supposer que l’hémisphère gauche est essentiel à la latéralisation de certains types de mouvements de la main [13] . Les patients cérébro-lésés à gauche mais sans paralysie du côté droit peuvent avoir, avec l’une et l’autre main, des difficultés à reproduire une séquence de mouvements et des positions complexes des doigts. Selon Kimura, ces observations peuvent être mises en relation avec d’autres données, recueillies chez des personnes sourdes et muettes, utilisant pour communiquer des mouvements manuels ; après une lésion de l’hémisphère gauche, elles manifestent des troubles de ces mouvements, similaires aux perturbations de la parole dont souffrent habituellement les sujets normaux après de telles lésions.
À partir des données issues d’un grand nombre de patients atteints d’une pathologie cérébrale unilatérale, Doreen Kimura parvient à la conclusion que l’hémisphère gauche est spécialisé dans le contrôle des musculatures orales et manuelles, que l’objectif soit ou non la communication. (…)
De tels résultats ont conduit Kimura à conclure que la spécialisation de l’hémisphère gauche pour le langage est une conséquence, moins de l’évolution dissymétrique des fonctions symboliques que de l’évolution de certaines habiletés motrices qui se prêtent aisément à la communication. En d’autres termes, l’hémisphère gauche a développé le langage, non parce qu’il a acquis graduellement des compétences plus symboliques ou analytiques, mais parce qu’il s’est bien adapté à quelques catégories de l’activité motrice.
Il est possible que les avantages évolutifs offerts par le développement d’une main habile à manipuler soient parvenus aussi à constituer le fondement le plus utile sur lequel construire un système de communication : ce système, d’abord gestuel et utilisant la main droite, utilisa plus tard la musculature vocale. En conséquence, l’hémisphère gauche finit alors par posséder un monopole virtuel sur le contrôle des systèmes moteurs engagés dans l’expression linguistique, qu’il s’agisse de la parole ou de l’écriture. [14] »
Cette hypothèse est étroitement liée à celle de la famille des modèles actifs de perception de la parole selon laquelle cette dernière implique un accès direct aux processus de production. Cette théorie pourrait aller dans le sens de la conception de Tomatis qui veut que la prédominance de l’oreille droite dans la latéralité du langage s’explique par l’asymétrie des nerfs récurrents (le droit étant plus court que le gauche) innervant les muscles du larynx, principal acteur de la production de la parole.
c) La disposition du fœtus à la fin de la grossesse
On trouve dans l’ouvrage de Bernard Auriol, une hypothèse qui nous semble intéressante quant à l’origine de la latéralité, qu’elle soit motrice ou auditive.
Il est dit, en effet, que durant les trois ou quatre derniers mois de la grossesse, le fœtus dont l’appareil auditif fonctionne à partir du 5e mois, tend à se maintenir dans une position qu’il conservera le plus souvent jusqu’à l’accouchement. Deux positions sont ainsi observée :
- l’une dans laquelle le fœtus est disposé tête en bas, l’arrière de son crâne étant du côté gauche du bassin de la mère (fig 21A). Il s’agit de la position la plus commune appelée « présentation du naissant en OIG (occipito-iliaque-gauche) ;
- l’autre étant une rotation de 180° selon l’axe vertical (quand la mère est debout) de la première et est appellée OID (D pour droit, fig. 21B).
Or, Bernard Auriol nous dit, citant Churchill [15] et Grapin [16] qu’« il existe un lien statistique entre la préférence manuelle du bébé (puis de l’adulte) et le type de présentation de sa naissance (OIG : droiterie [17] ; OID : gaucherie). [18] » Plus loin, nous lisons :
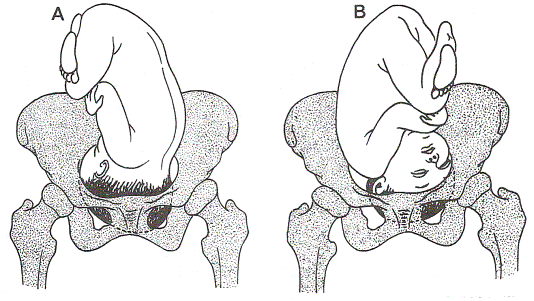
Fig. 21 [19]
« La position OIG favorise les contractions avec déplacement (« isotoniques ») des muscles situés à droite et les sontractions d’appui (« isométriques ») pour les muscles situés à gauche : en effet le côté droit du corps est proche de l’avant de la mère, plus souple, alors que le côté gauche du fœtus est proche du dos maternel moins mobilisable (Moos, 1929). Il se produit donc un conditionnement et même une « empreinte » liés à cette situation. Le système nerveux, qui est alors en pleine construction, inscrit dans sa structure même la facilité des contractions isométriques à gauche et isotoniques à droite. Mais ceci n’est valable qu’après six mois de grossesse (le fœtus bouge activement à partir de quatre mois et demi ou cinq mois). En effet les grands prématurés seront, à quatre ans, gauchers à 50 % alors que les autres seront bien plus souvent droitiers (90 %) (O’Callaghan [20] , 1987). [21] »
Enfin, concernant la latéralité auditive, nous comprenons que l’oreille droite du fœtus, en OIG, sera plus proche de la paroi abdominale de la mère et, par là, « sensibilisée aux bruits externes », alors que l’oreille gauche, proche du sacrum maternel, « sera davantage soumise aux bruits organiques (aorte, colon) et à la conduction osseuse de la mère (fondamental de la voix de la mère, bruit des pas, etc.) [22] . »
2.3. Hypothèses sur le traitement des sons de la parole
Les chercheurs du Laboratoire Haskins ont découvert que les modifications rapides de fréquences qui signalent b dans la syllabe « ba » sont différents de celles qui signalent b dans « bi » ou « bo ». La structure acoustique d’autres consonnes change aussi selon la voyelle de la syllabe.
Comment comprendre la fait que nous entendons comme des sons identiques les différents d (ou les différents b) ?
Une théorie découlant des recherches du Laboratoire Haskins propose que la similitude de production est responsable de la similitude de perception :
« Selon la théorie motrice de la perception de la parole, pour percevoir les sons du langage, en réalité, le cerveau humain « calcule » ce qu’il aurait dû faire pour les produire. Ces spécialistes du langage ont longuement œuvré à expliquer ce qui permet de comprendre si aisément des paroles prononcées de manières si diverses : une caractéristique semble rester invariante dans les diverses prononciations, c’est la façon dont la gorge, la bouche, les lèvres et la langue sont contrôlées pour la production de ces sons. [23] »
Plusieurs études d’imagerie cérébrale ont fourni quelques résultats étonnants qui corroborent la théorie motrice de la perception de la parole. Dans un travail utilisant la méthode de mesure du débit sanguin, les auteurs observent des augmentations importantes du débit dans l’aire de Broca, au cours d’une tâche où des volontaires normaux doivent identifier les mots contenant le son « br » dans des séries de mots enregistrés [24] .
Dans une étude avec la technique TEP [25] , on observe aussi une augmentation du débit sanguin dans l’aire de Broca, pendant une tâche où les sujets doivent décider si des paires de syllabes données oralement se terminent ou non avec la même consonne [26] .
Dans ces deux études il s’agit de tâches comportant seulement la perception de sons de langage, sans production de paroles. Les auteurs de ces travaux concluent que, pour la perception de la parole, leurs données corroborent l’idée du rôle actif des régions de production de la parole, incluant l‘aire de Broca.
2.4. Conclusion
Des efforts considérables ont été déployés pour caractériser la nature des différences fondamentales entre les hémisphères. Dans cette approche, on trouve l’idée que les différences hémisphériques peuvent être rapportées à une dichotomie fondamentale unique, par exemple, analytique/holistique. Les études qui ne cadrent pas avec ce genre de prédictions d’une dichotomie donnée la remettent en question et peuvent entraîner une reformulation ou une réévaluation de cette dichotomie.
a) Les cinq modèles dichotomiques
Dans un article de la revue américaine Brain and Cognition [27] , publié en Février 2008, l’auteur, Joseph Dien, nous expose les cinq modèles les plus connus à ce jour, tous basés sur une prédiction dichotomique, avant de proposer le “modèle de Janus“ (“Janus model“) qui semble englober les précédents. On distingue donc :
- Le modèle verbal (hémisphère gauche) / spatiovisuel (hémisphère droit) ;
- Le modèle catégorique (h. gauche) / coordonnée (h. droit) : il a par exemple été démontré que des sujets sont plus rapides à évaluer des relations catégoriques (au dessus / en dessous ) avec des représentations hémisphériques gauches et plus rapides à évaluer des relations de coordonnées (distance de 3 mm / distance plus grande) avec des représentations hémisphériques droites ;
- Le modèle analytique (h. gauche) / holistique (h. droit) : contrairement au modèle précédent, celui-ci s’intéresse à la façon dont est organisée une représentation plutôt qu’à la nature des relations entre différentes représentations.
- Le modèle routinier (h. gauche) / original (h. droit) : ce quatrième modèle concerne le processus d’apprentissage dans lequel l’hémisphère droit serait spécialisé pour la gestion de situations originales nécessitant de nouveaux systèmes de descriptions et l’hémisphère gauche spécialisé pour des situations requérant des systèmes de description routiniers déjà disponibles.
- Le modèle hautes fréquences (h. gauche) / basses fréquences (h. droit) : la plupart des impulsions initiales de ce travail sur les fréquences latéralisées résultent de l’effet local/global. Cette observation a été interprétée d’après les conclusions selon lesquelles la vision peut être décrite comme la décomposition de scènes en fréquences spatiales, de sorte que des dessins aux contours précisément délimités dans l’espace relèvent des hautes fréquences et les dessins flous et diffus correspondent aux basses fréquences. L’hémisphère gauche serait spécialisé pour le traitement des informations hautes fréquences tandis que le droit serait spécialisé pour le traitement des informations basses fréquences.
Une distinction « hémisphère gauche – local / hémisphère doit – global » dans la reconnaissance d’objet s’est progressivement associé à ce dernier modèle. Par exemple, la construction d’un motif, la lettre « T », à partir de motifs de plus petites dimensions, lettres « E », suggère que l’attention portée sur les motifs de petite taille est latéralisé dans l’hémisphère gauche tandis que l’attention portée sur le motif de plus grande taille est latéralisé à droite. Ce schéma interprétant les motifs de petite taille comme étant des objets locaux représentés par des hautes fréquences tandis que les motifs de grande taille sont considérés comme des objets globaux représentés par des basses fréquences.
b) Le modèle Janus
Ce modèle diffère des 5 modèles existants dans la mesure où il commence avec le niveau distancié et s’en sert pour diriger les spécificités des mécanismes du niveau rapproché plutôt que l’inverse.
Étant donnés les capacités observées des deux hémisphères d’opérer de façon semi-indépendante, bien que conjuguée, il est proposé que les hémisphères opèrent de cette manière dans les cerveaux unifiés normaux également. Cet article propose que l’hémisphère de gauche est généralement spécialisé pour anticiper les multiples futures possibles alors que l’hémisphère droit est généralement spécialisé pour intégrer les bribes d’information arrivant en une seule vue centralisée du passé qu’il peut dès lors utiliser pour réagir aux évènements lorsqu’ils arrivent.
Comme nous le voyons, le problème est loin d’être résolu en ce qui concerne les rôles des hémisphères cérébraux. Outre ces modèles basés sur des prédictions dichotomiques, d’autres auteurs sont partisans du traitement de l’information en parallèle par les deux hémisphères qui répartiraient les tâches calculatoires de façon modulaire dans les différentes zones du cerveau.






