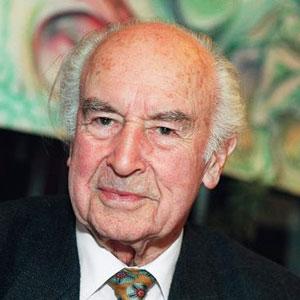Introductioon aux Méthodes de Relaxation
Dr Bernard Auriol
CHAPITRE XVIII
Nous ne nous attarderons pas ici sur les produits « convulsivants
» qui ont été utilisés, à une époque, pour réaliser des sortes d’électrochocs
chimiques. On assistait alors à trois phases :
1) contraction généralisée
des muscles,
2) convulsions,
3) coma.
Après un certain nombre de ces chocs (affreusement angoissants), le patient
retrouvait une humeur non-dépressive (quand cela marchait).
L'utilisation de l'insuline fait également partie du passé. Il s'agissait
de provoquer un coma en abaissant la quantité du sucre présent dans le sang.
Ensuite on « resucrait » le patient. On invoquait, pour expliquer la réussite,
dans certains cas, de ce traitement, des phénomènes biologiques et endocriniens
mal éclaircis, des données psychothérapeutiques parfois confuses (régression-déstructuration,
maternage-restructuration) qu'on aurait pu remplacer de manière plus modeste
et moins dangereuse par des enveloppements humides, des bains, etc.
Il arrivait qu'on prenne une demi-mesure : chocs « humides
» ; il s'agit de resucrer avant l'apparition du coma, à la phase de transpiration
produite par l’hypoglycémie.
Avant l'apparition des médicaments modernes, on a largement utilisé les barbituriques ;
non seulement pour faire dormir ou pour éliminer les crises d'épilepsie (ce
à quoi ils servent toujours), mais aussi pour tenter de maîtriser l'agitation,
le délire ou l'angoisse.
L'hydrate de chloral était employé dans le même esprit ; on sait maintenant
qu’il peut, à la longue, donner des hallucinations.
Par ailleurs, ces médicaments sont susceptibles de pousser le patient à la
toxicomanie. Il s'y habitue, ne peut plus s'en passer, a besoin de doses croissantes.
Le « bon vieil alcool », même quand il s'agit de vin vieux, ne me paraît
pas meilleur en dehors de limites très précises[2]. Il a certes des effets
antidépresseurs, il diminue l'anxiété, élimine certaines timidités ou peurs,
etc. Cependant l'usage habituel comporte plus d'inconvénients que d'avantages ;
comme le chloral, il peut, à la longue, provoquer des hallucinations, des délires,
voire le delirium tremens qui conduit rapidement à la mort en l'absence de réanimation
intensive.
Je ne pense pas beaucoup moins de mal du
haschisch et de toutes les déclinaisons du cannabis ou de
ses dérivés.
Leur effet facilitateur des relations se joue à un niveau
assez superficiel. Ils peuvent provoquer une décontraction parfois utile,
permettre l'accès à des données imaginaires jusque-là trop contrôlées
(le L.S.D., plus violent, a le même effet mais pas plus d’intérêt). Ce
genre d'expériences ne peut se faire n'importe comment. En effet, sous
l'action révélatrice de ces produits, on peut accomplir des actions irréalistes
ou suicidaires.
Qui plus est, ces produits, d'abord vantés comme clés
de la spiritualité conduisent à des expériences tronquées, n'engageant
qu'une partie de l'organisme et, à la longue, tendent à décaler la personne
de tout investissement réel ou responsable. Les rigidités éducatives ne
sont perdues qu'en apparence et le vrai soi ne se construit pas pour autant
en l’absence de charpente et d'engagement. L'or qu'on avait cru capter
se ternit en sable,.. |
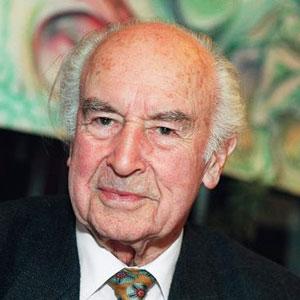 Albert Hofmann
Albert Hofmann, créateur du LSD. |
Licite ou non, l'usage des «drogues douces » implique une part d’autodestruction
qui peut aller, assez fréquemmnt, jusqu'à certaines formes de psychose
(par ex. la psychose cannabinique).
Ils sont peu utilisés en psychiatrie (en dehors de la préparation aux électrochocs
quand on pratiquait - ou pratique encore - cette technique). Ce sont les «
curarisants » et produits similaires, qui agissent à la jonction du
nerf et du muscle. Il existe aussi des produits qui visent les centres cérébraux
(méthocarbamol, styramate, chlorzoxazone, carisoprodol). Ces produits ont en
même temps une action contre la fièvre et peuvent calmer certaines douleurs.
C'est dans cet esprit qu'ils sont généralement employés. On s'en sert aussi
pour relaxer certains spasmes musculaires aigus, les tensions du tétanos et
des douleurs thalamiques incontrôlables par d'autres moyens. On utilise aussi
de faibles doses de toxine botulique injectées au niveau des cordes vocales,
par exemple, dans certains cas d’aphonie psychogène, spasme facial, torticolis
spasmodique, etc..
Les neuroleptiques, fréquemment utilisés en psychiatrie pour calmer,
réduire les hallucinations et les délires, etc., ont pour effet de provoquer
une contracture musculaire et des tremblements ressemblant à la paralysie agitante
(Parkinson). On utilise alors des « correcteurs » (artane, disipal, etc.)
qui diminuent cette rigidité et ce tremblement. Le tremblement du fumeur de
tabac est également amélioré (mais il me semble préférable de lui proposer d'arrêter
de fumer).
Ils font l'objet d'abus gigantesques dans le cadre de l'activité médicale du
praticien qui s'institue « distributeur de sérénité au rabais » et aussi selon
le processus de l'automédication ou dans le cadre de la toxicomanie multiple.
On devrait s'en servir uniquement dans des situations exceptionnelles, pour
des patients névrosés en début de cure psychothérapeutique ou à certaines articulations
de cette cure.
Les propanediols (équanil ou meprobamate, tybamate...) provoquent une relaxation
musculaire importante, diminuent l'agressivité, renforcent l'action des somnifères,
diminuent l'émotivité, permettent de mieux supporter les frustrations
Les benzodiazépines (valium, librium, nobrium, mogadon, témesta, séresta...)
sont anticonvulsivantes, calment « la souris combattante et le singe vicieux[3] », diminuent les phénomènes de crainte et d'angoisse.
On les utilise de ce fait souvent dans le traitement chimique des symptômes
névrotiques. Le danger de toxicomanie avec phénomène de besoin, accroissement
des doses, etc., existe pour ces produits.
Je fais l'hypothèse qu'ils diminuent également le niveau des aspirations, l'ambition,
la capacité de compétition... D'autre part, on a découvert récemment qu'ils
altèrent la mémoire et modifient les réactions de l'organisme par rapport aux
substances étrangères : ils stimulent la production d'anticorps et activent
les macrophages[4].
Ceci n'a pas que des avantages puisque, à l'usage, pourraient se développer
les réactions d'auto-immunité[5]
(attaquer ses propres tissus) et qu'au sevrage une plus grande fragilité aux
infections serait à craindre...
L'aspirine ne semble pas capable d'un véritable effet de cet ordre, sinon indirectement,
lorsqu'elle soulage une douleur et permet que la personne se détende.
La cocaïne et ses dérivés entraîne l'anesthésie locale et, pourtant, a un
effet global d'excitation sur le cerveau. Elle soulage de la sensation de faim,
diminue l'impression de fatigue, augmente la quantité de mouvements et d'actions,
accélère et amplifie la respiration (à dose modérée).
La morphine et ses dérivés, ainsi que les substances naturelles qu'elle singe
(enképhalines, endorphines), provoquent chez le malade douloureux la disparition
de sa souffrance, de sa tension psychique, qui peuvent céder la place à l'euphorie
ou au moins à l ‘ indifférence à l'égard du traumatisme. Si on aboutit à l'excès,
on peut observer une obnubilation. Au niveau de la thérapie de relaxation, la
morphine (et ses dérivés) ne se justifie que dans les cas de douleur insupportable.
Chacun sait combien abusent de cet effet euphorisant et anti-douleur, soit
après avoir été traités médicalement, soit pour avoir été convaincus d'essayer,
à plusieurs reprises, à titre de drogue « illicite ». Un usage habituel ne conduit
pas véritablement à la relaxation mais plutôt à la tension du manque et à l'escalade
des doses avec tous les problèmes pour se procurer le produit. Les techniques
de relaxation, l'acupuncture, les bêtabloquants[6],
le catapressan et l'appui d'un groupe chaleureux peuvent permettre à celui qui
le désire de « décrocher ». Les techniques sonores (type sons filtrés) donnent
également d'heureux résultats. Les traitements imposés par la Justice semblent
conduire à de nombreuses rechutes[7]. Par ailleurs le besoin de drogue
paraît directement lié aux formes inhumaines de notre culture. Je veux parler
du besoin de drogue tel que nous le connaissons. En effet la relaxation (par
l'alcool, le tabac, le kif, l'opium, etc.), a existé dans de nombreuses civilisations,
éventuellement sous la forme du sacré. Mais il s'agissait d'un usage sporadique,
limité, dans un but festif, convivial ou initiatique. Nous en sommes loin !
On sait que les activités musculaires ou respiratoires intenses et prolongées
provoquent la fabrication naturelle par l'organisme d'enképhalines (semblables
à la morphine). Le premier traitement de l'angoisse et de la souffrance psychologique
doit être une pratique physique aussi sportive que s'en montre capable le sujet.
Pour y atteindre de façon régulière, l'entraînement par le groupe ou une personne
amie s'avère souvent indispensable et toujours utile.
On connaît une maladie (« polyenthésopathie »), caractérisée par une insomnie
accompagnée de douleurs multiples à tous les niveaux du corps ; elle semble
liée à une fabrication insuffisante d'enképhalines par l'organisme[8]. Les antidépresseurs (I.M.A.O., tricycliques, etc.)
permettent à un certain nombre de personnes frustrées, de manière aiguë ou chronique,
de supporter leur privation (d'amour, d'emploi, d'estime, d'intérêt...) pendant
plus longtemps. Mais si elles ne peuvent modifier leur situation, remettre en
cause leur propre fonctionnement, il est fréquent de les voir rechuter et rechuter
encore. Les thérapies dont nous avons parlé tout au long de ce livre peuvent
leur permettre d'aller plus loin, d'envisager certaines modifications, d'entreprendre
une évolution personnelle.
On a prouvé récemment que le millepertuis[9], à la dose d’un demi gramme d’extrait
par jour, est un antidépresseur d’action aussi puissante que les classiques
« tricycliques[10]
». Cette plante à fleurs jaune, à qui la Grèce antique reconnaissait le
pouvoir de chasser les mauvais esprits, n’a pas d’effets secondaires connus
et a une action favorable sur le sommeil par la mélatonine qu’elle contient.
On a pu montrer que les sucres ont une action favorisante sur le sommeil, les
abonnés de la sieste le savaient et les insomniaques peuvent en prendre usage
de réserver leur dessert et autres sucreries pour le soir. Ceci est un détail,
simple aménagement horaire.
G. Burger et d'autres auteurs proposent une discipline autrement prenante dans
sa très grande simplicité ; sa proposition est de s'adonner à une alimentation
instinctive (" mangez ce qu'approuve votre odorat et seulement cela, ne
le faites pas cuire, arrêtez d'en prendre dès que le goût change ou s'affaiblit
pour, si vous avez encore faim, chercher un autre mets... Mangez tout ce qui
vous plaît - sauf les dérivés du lait - pourvu que ce soit cru et non mélangé").
Cette « anopso-thérapie » (anopso = sans cuisson) ridiculise,
entre autres choses, le « mythe » du petit déjeuner obligatoire qui serait
inutile, sinon nuisible, excepté pour les enfants. Il s'agirait de revenir à
une mentalité d'avant Prométhée, ce dernier marquant le passage de l'intuition
à la raison, de la communauté à la famille, de la longévité à la brièveté de
la vie... Quelle que soit l'appréciation que l'on porte sur cet éventuel « âge
d'or » dépourvu de manque (?), les adeptes de l' « Instinctothérapie
» (autre nom de la méthode) revendiquent une diminution du stress (retour du
sommeil, diminution de l'angoisse, de la timidité, du vertige), la guérison
de certaines maladies (allergiques, autoimmunes ou même néoplasiques (?)) ».
Il existe un argument d'ordre vétérinaire : les porcs nourris de cette
façon se détendraient ; en particulier leur queue perdrait son allure classique
« en tire-bouchon » témoin d'une attitude stressée ; elle se mettrait à se balancer
vigoureusement comme celle d'un chien satisfait !…
Cependant il ne semble pas que cette pratique ait obtenu les confirmations
scientifiques nécessaires et Burger a été mis devant les Tribunaux
car il ferait l'apologie de la pédophilie ! … Pourtant, il existe
d'autres promoteurs du crudivorisme
qui paraissent beaucoup plus "clean" !
©
Copyright Bernard AURIOL (email :
)
2 Mai 2008
Ce chapitre est rédigé en utilisant de manière
très libre l'excellent ouvrage de H. LABORIT, Les Comportements :
biologie, physiologie, pharmacologie, Masson, 1973. p. 403.
H. LABORIT, op. cit., p. 258.
Cf. Le corps et l'esprit.
Science et société, in Pour la Science, 107,7-8, sept. 86. Il est possible
qu'il y ait une parenté profonde entre les mécanismes immunitaires et les
phénomènes de l'angoisse et de la mémoire. Le système immunitaire boucle en
permanence son action sur lui-même. les anticorps étant contrôlés par des
anticorps d'anticorps, etc. La mémorisation à long terme implique un stockage
chimique de l'information qui doit être à la fois stable et souple. comporter
des possibilités d'oubli (et donc de destruction d'information), interagir avec
le système génétique (ARN ou ADN). On peut imaginer que la sélection des
informations mémorisées le soit selon un système bouclé sur le même modèle et avec des médiateurs
analogues (BZD-Iike) que le système immunitaire.
[6] B.Auriol, N. Palandjian, M. Bord, A. Vals, Les bêtabloquants en psychiatrie
Nouv. Press. Méd. I, N°21, p.1439, 1972 ; B. Auriol, Le problème des béta-récepteurs
en Psychiatrie,
Etude critique de la littérature et observations cliniques, C.E.S. Psychiatrie
- Toulouse III - 215 pages – 1973 ; B.Auriol, N. Pinar et M. Bord, Le
Pindolol, un nouveau psychotrope, l'Encéphale N°5, 15 p., 1973.
Cf. F. Blotman, comm. aux 9e journées de Rhumatologie
de la Conception ; Marseille, mars 87 ; C.R. in Q.M., 30.03.87).