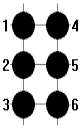De-voir
Dr Bernard Auriol
|
¤ De voir, l'écriture
du bien-voyant et de l'aveugle (15 Août 2001)
D'après Saudek l'écriture se fige quand survient la
cécité. Que cela peut-il signifier ? Par ailleurs le
Braille comporte des caractéristiques très particulières
par rapport à la gestion de l'espace symbolique. Conséquences.
After saudek, handwriting characteristics are
fixed at the moment of blindness. What does it mean ? Braille handwriting
is built in a very special fashion regarding management of symbolik
space. Consequences...
|
L’écriture du voyant
Second degré de la parole
Pour la communauté des bien-voyants il s’est avéré
avantageux, au delà de la symbolisation qu’opère le langage, de sur-symboliser
ce dernier dans un second degré étonnant, de le retourner à la trace dont
il sortit : ils ont inventé l’écriture !
L'oral et l'écrit si intimement liés ont engendré pourtant
deux voies culturelles, deux façons d'être à l'autre, deux lieux du cerveau :
à côté des cultures orales qui subsistaient, se sont constituées des cultures
écrites, capables d’aller, avec Champollion au delà de la perte du code, de
l’oubli collectif.
La parole est la manifestation matérielle de l'esprit, ombre
qui le révèle et le mortifie. Elle est foisonnante de questions. L'écrit est
comme le reflet de cette ombre. Plutôt que de dire « la
lettre tue et l’esprit vivifie », Jousse préfère rester au plus près
des étymologies, ce qui donne : « Le graphisme donne la mort
et le souffle donne la vie » (II Cor, 3-6).
La Source Propre
L’éthologie nous met en présence d’une origine anale
de l'acte graphique qui se laisse découvrir dans les frontières qu'on
trace, le bornage des propriétés, les marques apposées aux objets
personnels (ex-libris, initiales du trousseau, tatouages des bestiaux
ou des humains, etc.). Les brahmanes, dit-on, ne devaient pas regarder leurs
fèces : cela eut pu les souiller.
L'histoire de l'écriture nous enseigne (Leroi-Gourhan,
1964 et 1965) que l'idéographie tend à une symbolisation, une abstraction
contractuelle toujours accrue, jusqu’à la phonétisation de l’alphabet, à la
typographie, à l’abréviation des sigles et de la sténotypie.
|
-- --- .-. ... .
/ -.-. --- -.. . / .- -. -.. / -... .-. .- .. .-.. .-.. . / -.-. ---
-.. . /
|
|
--. --- / .. -. /
- .... . / ... .- -- . / -.. .. .-. . -.-. - .. --- -.
|
Les codes morse
et braille vont dans la même
direction. Notons ici que le morse, de moins en moins nécessaire chez les
marins ou les militaires, est peu à peu abandonné. Pourtant, il eut pu être
un intéressant compétiteur du Braille. En effet le morse est un système de
points, de traits et d’espaces qui peuvent se lire tactilement, auditivement
et visuellement, sans ambiguïté et à grande vitesse, que ce soit par des individus
mal ou normo-voyants pourvu qu’ils soient entraînés (Février, p.540-541).
Désolation du traitement de texte informatisé : plus
de trace de ces ratures, de ces pâtés qui donnent tant de prix au manuscrit
de Madame Bovary...
L'algèbre est une élévation de l'écriture à sa propre
puissance, une formation réactionnelle relativement à l'analité dont
elle procède. La lettre algébrique est symbole de symbole de symbole, c'est
le joker qui permet de généraliser le maniement du jeu et sans y perdre aucune
rigueur !
Le langage des signes permet au mal-entendant ou au
marin de communiquer avec des gens très éloignés par la langue parlée. Il
va plutôt à rebours de l’algébrisation en raison de son utilisation de la
simultanéité spatiale !
L'Ecrit invite au Commentaire et à l'Herméneutique.
C'est l'explication, la désintrication, le défilement du texte (qui en reçoit
consécration) [12] , dévoilement jamais pris en défaut par absence de feed-back;
dévoiement diront les tenant de l'orthodoxie; suspecte infaillibilité, dans
tous les cas infalsifiable...
Le fatum c'est l'inévitable, la destinée qui aboutit
toujours à la mort, au cadavre. Le fatum correspond à une énonciation divine
qui ne peut être modifiée, tout comme un écrit, elle demeure. Le destin c'est
le dessin de quelque divinité ou de l'Inconscient. Telles les bonnes sœurs
sorties de l'esclavage, je parle des Papins qui écrivent en dehors de la page
: elles font à leurs maîtresses défense d'y voir puis s'acharnent à
en marquer le corps, gratuitement pourrait-on dire, s'il ne s'agissait d'un
salaire, et de s'écrier d'anti-écriture en anti-phrase : "en voilà
du propre !".
C’est dit, l'écriture
est une sublimation anale de la parole !
Main ou cerveau ?
D’un point de vue neurophysiologique, l’écriture dépend avant tout du cerveau
et, si elle dépend aussi de l’organe utilisé pour la produire, c’est seulement
en cas de handicap. Ce sont déjà les expériences de Preyer (1895-98) qui ont
permis de l’affirmer : il se fixa un crayon à la tête, à la bouche, au
coude, au genou, aux orteils, et après quelques exercices, l’écriture obtenue
reproduisait chaque fois la forme fondamentale de son écriture habituelle !
Il put en conclure :
« Die Handschrift ist Gehirnschrift »
Plus tard (1937), S. Pellat et R.A. Schuler renchérissent
déclarant que « l’organe traceur n’est qu’un appareil passif ».
A cela, H. Callewaert, s’appuyant sur des enregistrements cinématographiques,
objecte que la façon de tenir le porte plume peut entraîner des modifications
notables du graphisme.
Comment l’œil et la main se partagent-ils la production
des éléments significatifs – au sens graphologique - de l’écriture ?
Le cerveau gouverne la main, décide de sa position (tenue de plume), mais
il le fait en tenant le plus grand compte du résultat, de l’image qu’il tient
à produire, laquelle ne se borne pas au sens du texte.
Le graphisme, geste ou image ?
Cependant, ce résultat laisse ouverte la question
de savoir si l’écriture le style du graphisme, est la trace d’un geste ou
si elle est la réalisation d’une image.
a.
L’animal et l’homme manifestent des émotions, des instincts, des désirs sous
la forme d’une expression : mouvements, gestes, action sur les objets
et sur l’environnement. Ceci par tous les canaux d’action disponibles sous
le contrôle ou sans le contrôle des canaux sensoriels correspondant.
b. L’écriture
est produite par des mouvements. Quel type de mouvement ?
i.
Volontaires plus ou moins servis par des automatismes (ex. :
la marche, la technique de l’écriture en tant que production de structures
alphabétiques reconnaissables). Ces mouvements servent une compétence neurologique
(praxie) en vue d’une formulation symbolique (ce que le scripteur veut signifier).
Ils dépendent, à la base, des conditions matérielles de production (stylo,
papier, support, etc.) et de l’existence d’un apprentissage correct (lecture,
technique calligraphique transmise par l’instituteur, etc.).
ii.
Réflexes (ex. : la fermeture de l’œil quand on touche la cornée,
la crampe de l’écrivain par réaction à une technique d’écriture défectueuse)
iii.
Expressifs (ex : mimique de frayeur, de joie, de colère, irrégularités
de l’écriture liées à l’émotion)
iv.
Volontaires (ex : aller chercher un objet )
v.
Volontaires automatisés (ex : la marche, se rattraper quand on
trébuche, tricoter, lire, écrire )
c.
Ces quatre types de mouvements coopèrent dans la plupart des actions. On cherche
alors à déterminer dans un mouvement quel qu’il soit la façon dont ces différentes
catégories interviennent : on remarquera avec Ludwig Klages que « le
caractère personnel se manifeste dans tout mouvement volontaire (notamment
l’acte d’écrire) ». Assurément, celui qui a des gestes raides, saccadés,
rectilignes aura aussi un trait graphique rigide, droit, saccadé… L’émotion
qui modifie les gestes en général, modifie aussi l’écriture qui en représente
la trace, comme l’a montré Georg Meyer en 1898. Il étudie le fait que les
lignes, au lieu d’être tracées horizontalement, peuvent monter ou descendre.
Il s’appuie sur la théorie de l’expression de Lange. L’écriture est une production
individuelle et de même le mouvement qui la produit. Ce caractère individuel
est rattaché non seulement aux émotions du scripteur mais aussi à son caractère,
par les graphologues.
L’écriture à perte de vue
(l’aveuglé s’en tient à sa première impression)
Thèse de Saudek : l’écriture des personnes qui
deviennent aveugles cesse d’évoluer ; elle se fige dans la forme qu’elle
avait avant la cécité. Il appuie cette affirmation sur de larges statistiques.
Le résultat logique de cette théorie est que les formes
de l’écriture cessent de s’adapter à l’évolution du caractère, quand l’organe
de contrôle, l’œil, cesse de fonctionner.
Les observations et expériences de Saudek concernent
des personnes devenues aveugles : par exemple, l’expertise en écriture
attribue facilement à la même personne son graphisme d’autrefois et celui
qu’elle trace après être devenue aveugle à la guerre.
Par contre, l’écriture du bien-voyant à qui on bande les
yeux est très troublée par ce procédé, par exemple il a beaucoup de difficulté
à produire des m ou des n avec le nombre exact de jambages qu’ils requièrent :
c’est dire l’importance du contrôle visuel pour réaliser le graphisme anticipé
dans la représentation.
Chez l’aveugle, l’image graphique des derniers
temps avant sa cécité joue un rôle tellement déterminant que le style graphique
ne change plus,
dominé qu’il est par les automatismes acquis et manquant du contrôle qui serait
nécessaire à en créer de nouveaux.
Emile Javal a proposé une planchette conçue pour permettre
au sujet devenu aveugle d’écrire selon des lignes successives horizontales :
la planchette à écrire. Ou planchette « scotographique ».
C’est dire que la stabilité de l’écriture dont parlait Saudek doit se réfèrer
plus aux détails de la forme qu’à l’ordonnance de l’ensemble !
A l’importance de la mémoire visuelle, il faut bien sûr
adjoindre celle des capacités kinesthésiques. Le devenu aveugle est amené
à reconstruire son espace à partir des sons, des mouvements et de leur résultat
tactile ou auditif. Il reste fidèle quant à l’image à ce qu’il en peut saisir,
celle de son passé de voyant. Le voyant quant à lui évolue, voit évoluer les
représentations qu’il se fait de lui-même et du monde ; il adapte sans
cesse sa production à ces changements, ce qui rend compte des modifications
– d’ailleurs assez peu fréquentes – de sa représentation graphique et de son
écriture.
Les observations de Saudek sont à rapprocher de la théorie
de Ludwig Klages sur l’image directrice individuelle.
Le contrôle de qualité
Pour H. Callewaert, l’acte d’écrire, est (…) l’équivalent
de « l’articulation » et de la « phonation ».
d. Le
sourd de naissance peut être « oralisé », c’est dire qu’on
l’oblige à parler sans qu’il puisse en percevoir le résultat, il parle mais
ne sait ce qu’il dit !
e.
Le devenu sourd ne désapprend pas la parole mais, avec les années,
on perçoit un changement notable du timbre de sa voix.
Klages l’affirmait déjà en 1906 : « le contrôle
de l’ouïe influe sans cesse inconsciemment sur notre parler ». C’est
à la base des trois lois énoncées et validées par Alfred Tomatis :
o
la voix ne contient que ce que l’oreille entend.
o
si l’on modifie l’audition, la voix est immédiatement et inconsciemment modifiée.
o
il est possible de transformer la phonation par une stimulation auditive entretenue
pendant un certain temps.
Plus généralement, Klages démontre que pour toute action,
se forme inconsciemment une image anticipée de son résultat et les mouvements
mis en œuvre pour cette action sont conditionnés par cette représentation
du résultat.
Ainsi l’écriture nécessite-t-elle l’intégrité des voies optiques
et du centre gnosique visuel, parce que ce centre de la reconnaissance des
mots nous sert constamment à vérifier que ce que nous écrivons correspond
suffisamment bien à ce que nous projetions d’écrire. Si le sujet devenu aveugle
reste capable d’écrire c’est qu’il a conservé le centre gnosique de l’écriture.
Il s’agit du centre cérébral qui supporte les automatismes (ou praxies) acquis
avant que ne survienne la cécité.
Voir de l’oreille
Il convient aussi d’admettre que ce contrôle peut – avec
l’entraînement – substituer l’ouïe à la vue !
Un illusionniste entraîné parvient en effet, le dos tourné
au scripteur, à distinguer par l’ouïe les crissements de la craie des lettres
tracées au tableau noir. Il parvient à en reproduire le texte et même les
caractéristiques dominantes du graphisme.
L’impression d’abord !
image directrice (ou anticipatrice) personnelle (« Leitbild »)
L’homme (seul ou beaucoup plus que l’animal) a des représentations
qu’il introduit dans son expression.
C’est ainsi que le mouvement graphique est conditionné, non
seulement par le texte à communiquer, mais aussi par la représentation
symbolique de l’espace propre au scripteur. Autrement dit, le scripteur
choisit, par l’intermédiaire de l’œil, la forme graphique qui correspond
à ses vœux inconscients (Hegar). Ce choix est de nature non-consciente
alors même que le scripteur en recouvre les raisons profondes par des motifs
qu’il croit connaître.
Le sujet écrivant cherche à produire une certaine impression
chez soi-même et chez autrui, il offre ainsi une sorte d’autoportrait
permanent ; l’expression représentation est une expression-impressive !
Cette expression-impressive signifie plus qu’elle n’exprime.
D’après Klages complété par Hegar, tout mouvement conscient
est, à tout instant, modelé par l’attente inconsciente de son résultat intuitif
quant à impressionner un être vivant. En fait « les mouvements impressifs
présupposent la communauté des êtres à laquelle ils s’adressent ».
L’individu subit toutes sortes d’impressions de la part des
objets et personnes qui l’entourent et dont certaines sont privilégiées par
son inconscient, d’autre part il agit pour les impressionner ou s’impressionner
lui-même. Partant d’impressions inadéquates pour lui, le sujet tente de produire
des impressions qui lui conviennent mieux, cela par identification, identification
négative (être l’inverse de l’autre), visée symptomatique, etc.
L’expression quand même !
Pour Hegar, tout dans l’écriture dépend de l’image anticipatrice
sauf le trait qui échapperait à cette activité de représentation. Il
ne serait pas iconique mais purement expressif, impact du réel du sujet dans
sa production. On pourrait le rapprocher du fondamental de la voix,
plus dépendant de l’âge, du sexe des hormones et de la morphologie que le
timbre, plus proche de la représentation dans sa version sonore.
On voit combien il est important – et difficile – de différencier
le principe d’expression du principe de représentation !
Question de Canal ?
L’attitude de manifester sa propre représentation
du monde, sa propre représentation de soi à travers une action de nature « impressive »
est inhérente à notre nature d’animal social, ou même d’animal tout court !
Cependant, elle est plus facilement – ou plus grossièrement – marquée chez
celui qui voit et se rend compte des réactions d’autrui à ce qu’il montre.
L’aveugle est limité dans ce domaine aux autres
canaux sensoriels, moins aptes à exacerber la rivalité, le narcissisme, etc.
D’où peut-être, l’impression qu’il donne d’être plus conciliant, plus amène,
plus sage que le sourd ou même le normo-voyant en général.
On trouve une illustration de cette
opposition dans « Le bon petit diable » de la comtesse
de Ségur. Dans la dédicace qu’elle en fait à sa petite fille, la comtesse
résume Juliette par « la douceur, la bonté, la sagesse et toutes les
qualités qui commandent l’estime et l’affection » ! L’aimable
Juliette est aveugle, le détestable sonneur de cloches du collège sera sourd et
frappera le malheureux Charlot en conséquence !
A chiffrage ennemi, chiffrage et demi
(de l’alphabet en relief aux demi dominos)
La mise en code de la pensée nous permet le langage,
ouvert à une communauté, mystérieux pour l’autre. Le codage du langage en
signes gravés, peints, tissés, noués ou écrits restreint la communauté des
parleurs à celle des lettrés. Lesquels s’ils veulent se former en sous groupe
et échanger secrètement chiffrent leur écriture. Par des procédés éventuellement
très simples et très habiles comme ces jeunes du siècle dernier qui condensaient
une correspondance secrète, formée de plusieurs dizaines de mots, dans l’espace
réservé au timbre poste, celui-ci n’étant collé ensuite que par son bord dentelé !
(Callewaert, p.25).
L’écriture, de hiéroglyphique, dessinée, est devenue,
en occident, alphabétique. Sa scription a été facilitée par l’habitude de
lier entre elles des lettres par ailleurs schématisées, ce qu’ont
malencontreusement refusé les romains et les germaniques (gothique).
Les enfants apprennent plus rapidement à écrire en « simple
script »
que si on leur propose la calligraphie traditionnelle. D’après Walter Hegar,
cela serait attribuable à la plus grande homogénéité entre caractères vus
au cours de l’apprentissage de la lecture et caractères à produire soi-même.
L’envers de la médaille est que cette séparation des lettres oblige l’enfant
à soulever sa main du papier par à coups, pour dessiner chaque caractère l’un
après l’autre, au lieu de glisser en suivant le fil d’une écriture « cursive ».
En revanche, l’admirable écriture de Bergson montre qu’il existe une forme
de juxtaposition sans interruption du rythme (Crépieux-Jamin, p. 256).
Il est évident que cette disjonction des lettres
nuit à la rapidité et à la lisibilité si l’espace entre les mots est peu différent
de celui qui sépare les lettres. Mais à cette « scriptio continua »
échappent le morse et le braille qui établissent des espacements suffisants,
en deçà desquels s’installerait la plus parfaite confusion !
Le Braille
Partage avec la typographie, l’ordinateur, la machine à écrire,
un conventionnalisme accru du graphisme par rapport à la calligraphie. Même
chez le voyant devenu aveugle, il a le mérite de permettre un contrôle tactile,
une relecture pendant et après l’action d’écriture.
En droit, on devrait pouvoir mettre au point une sorte de
graphologie de la scription braille, difficile et subtile certes, sans doute
trop ardue à acquérir pour mettre en œuvre les moyens pratiques de la permettre,
mais théoriquement possible !
Comme le calligraphe, le scripteur en braille se trouve affronté
à une page blanche : elle représente métaphoriquement les objets réels
auxquels le scripteur est affronté.
Symbolisme du point
Hégar a établi, chez le normo-voyant, que le point symbolise
l’affrontement du sujet à la matière, à l’objet physique représenté par le
papier. L’écriture braille est une succession de combats symboliques dont
les nuances pourraient s’énoncer à partir du symbolisme de l’espace.
On peut inscrire le signe avec plus ou moins de force, de
rapidité, de souplesse, produire plus ou moins d’erreurs, localisées préférentiellement
au point 1, au point 2 … au point 8 ! Avec bien sûr l’éventualité de
lapsus plus complexes. Notre inconscient injecte ses représentations et son
espace propre dans les formes que nous voulons produire et dans l’espace où
nous les projetons, tel que nous nous le représentons et tel que nous nous
représentons en lui !
On sait que « Le braille peut être écrit
à l'aide d'une tablette en métal, creusée de sillons parallèles et munie d'une
réglette percée de plusieurs rangées d'ouvertures rectangulaires et d'un poinçon.
Il s'écrit de droite à gauche et il faut inverser les lettres afin de les
lire en relief au verso ».
Nous devons reporter ces notions dans les tableaux ci-dessous :
Symbolisme de l’espace en lecture
| |
|
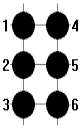
|
|
|
|
Passé idéalisé
|
Haut Gauche
|
Haut Droit
|
Futur idéal
|
| |
|
|
|
|
Mère
|
Milieu Gauche
|
Milieu Droit
|
Père
|
| |
|
|
|
|
Origine, Naissance
|
Bas Gauche
|
Bas Droit
|
Projet, Réalisation
|
| |
|
|
|
Symbolisme de l’espace en écriture
| |
|
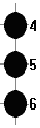 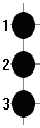
|
|
|
|
Passé idéalisé
|
Haut Gauche
|
Haut Droit
|
Futur idéal
|
| |
|
|
|
|
Mère
|
Milieu Gauche
|
Milieu Droit
|
Père
|
| |
|
|
|
|
Origine, Naissance
|
Bas Gauche
|
Bas Droit
|
Projet, Réalisation
|
| |
|
|
|
En rapprochant une partie des deux tableaux précédents, nous
avons :
En lecture
|
Passé idéalisé
Mère
Origine, Naissance
|
Futur idéal
Père
Projet, Réalisation
|
En écriture
|
Futur idéal
Père
Projet, Réalisation
|
Passé idéalisé
Mère
Origine, Naissance
|
| |
Gauche
|
Droite
|
Le symbolisme graphologique évoqué ici est basé sur deux
types de considérations :
- D’abord, le fait que le mouvement graphique va de gauche à droite symbolise
le mouvement de l’action et de la vie qui nous mène du passé vers le futur,
et par importation de stéréotypes socio-psychologiques, de la mère vers
le père. Du point de vue de cette appréhension « dynamique »,
le même symbolisme est respecté aussi bien en lecture qu’en écriture.
- Par ailleurs, on peut attribuer une signification symbolique « statique »
à la droite et à la gauche. L’espace de l’environnement du sujet, et aussi
de son corps propre, a des propriétés symboliques qui semblent assez universelles. Elles sont peut-être liées aux conditions de la
vie fœtale et aux conséquences du type majoritaire de présentation obstétricale
(OIGA).
Boustrophédon représentationnel
Dans le cas de l’écriture du braille, on se trouve dans un
cas de figure analogue, pour cette question, au problème que pourrait poser
aux graphologues l’écriture de l’arabe ou de l’hébreu qu’on écrit également
de droite à gauche.
Il faut aussitôt remarquer que, dans ce dernier cas, lecture
et écriture sont soumises à la même direction, alors qu’en braille, le sujet
doit inverser le sens de son parcours selon qu’il lit (GàD) ou qu’il écrit (DàG) ! L’usager du
braille est plus proche dans son comportement cognitif de celui des anciens
grecs qui, pour économiser les déplacements de la main, écrivaient une ligne
de G à D, la suivante de D à G, la suivante encore de G à D, et ainsi de suite,
tels les bœufs traçant un sillon après l’autre (boustrophédon) …
Symétrie symbolique
Un des tests d’exploration de la latéralité, consiste à écrire,
yeux fermés pour un voyant, un crayon dans chaque main, deux colonnes de chiffres
de 1 à 11. Ainsi peuvent apparaître, à côté du cas ou les deux colonnes présentent
des chiffres grossièrement identiques entre Droite et gauche, des chiffres
dont l’un est en miroir par rapport à son homologue de l’autre colonne. C’est
ce que l’on peut appeler un phénomène de bilatéralité : un hémisphère
compétent pour la forme des chiffres communique ses informations de structuration
à l’autre hémisphère, sans correction. De ce fait, ce dernier préside à un
tracé symétrique du modèle. On a pu dire que l’écriture en miroir est le
tracé normal pour la main gauche. D’autres considérations amènent pourtant
à envisager l’hypothèse qu’on se trouve là en présence d’une dominance
latérale incomplète, qu’on nommera une « bilatéralité ».
La conquête de l’espace
Dans le cas de l’écriture braille, ce qui serait en calligraphie
une forme d’insuffisance, devient une nécessité, sous réserve qu’elle soit
maîtrisée, gérable. Dans le meilleur des cas, sur la base d’une latéralité
neuro-cognitive bien établie, devra s’installer une capacité d’alterner la
gestion représentationnelle à dominante droite et à dominante gauche. On peut
rapprocher cette capacité de celle de certains sujets bilingues dont on a
découvert qu’ils parlaient une langue avec un hémisphère et une autre langue
avec l’autre hémisphère !
Si la vue est liée à l’hémisphère droit, on s’attendrait
à ce que sa perte conduise à une perte des fonctions neuro-psychologiques
de cet hémisphère. En fait, l’espace se construit sur les bases tacto-kinesthésiques
et auditives essentiellement. Le côté linéaire, digital du langage, et tout
spécialement du langage écrit ne triomphe pas comme défaut, il agit plutôt
comme manque et créateur d’une riche bilatéralité, que l’écriture Braille
elle-même suppose et engendre …
Bibliographie
1. Braille
L., Procédé pour écrire au moyen de points, 2° éd., 1837.
2. Callewaert
H., Graphologie et Physiologie de l’Ecriture, Nauwelaerts, 2°ed. 1962.
3. Crépieux-Jamin,
ABC de la Graphologie, PUF, 1950, p.256.
4. Faideau
P. et coll., La graphologie, Histoire, Pratique, Perspectives, 2° ed, MA éditions,
Paris, 1983.
5. Février
J., Histoire de l’Ecriture, Payot, Paris 1959.
6. Hegar
W., Graphologie par le trait, Vigot fr. ed., 1938, p. 9 et sqq.
7. Javal
E., Physiologie de la lecture et de l’écriture, Alcan, 1905 (et Retz, 1978).
8. Jousse
M., L’anthropologie du geste, Resma, 1969.
9. Klages
L., Das persönliche Leitbild, in
Graphologische Monatshefte, 1906.
10. Klages L., Expression du caractère
dans l’écriture, technique de la graphologie, Delachaux & Niestlé, 1947.
11. Klages L., Graphologie, Stock
ed., 1949.
12. Meyer G., Die Wissenschaftlichen Grundlagen der Graphologie,
Vorschule der gerichtlichen Schriftvergleichung, Gustav Fischer (1901,
1925, 1940, 1943).
13. Mounier E., Traité du Caractère,
Seuil, 1947. (pp. 208 sqq., )
14. Paulos de Tarse, II° épitre
aux Corinthiens (Cf. la Bible de Jérusalem, Cf. aussi la Bible de Chouraqui).
15. Preyer W.T., Zur Psychologie des Schreibens mit besonderer
Rücksicht auf individuelle Verschiedenheiten der Handschriften, Leipzig: Leopold
Voss: 1895, 1919, 1928.
16. Preyer, W.T., Graphisch fixierte Ausdrucksbewegungen (mouvements
d’expression fixés graphiquement),
Graphologischen Monatshefte, 1898.
17. Pulver M., Le Symbolisme de
l’Ecriture, Stock (1931 – 1953).
18. Saudek R., Experimentelle Graphologie, Berlin:
Metzer: 1929. 348 pages,( p.2 et sq., p.64).
19. Saudek, Robert, Experiments with Handwriting,
London: George Allen & Unwin: 1926.
20. Ségur née Rostopchine (Comtesse
de), Un bon petit diable, Hachette, éd de 1983.
21. Zaouche-Gaudron C. et coll.,
La problématique paternelle, Eres, 2001.
©
Copyright Bernard AURIOL (email :
)
15
Octobre 2001
«
L’écriture est du cerveau »
Hegar rapproche ce fait des phénomènes de synesthésie
plus fréquents chez les aveugles que dans la population générale : par
synesthésie, on entend la contamination d’une qualité perceptive par un autre
sens. Par exemple l’audition « en couleur » serait cinq fois plus
fréquente chez l’aveugle que chez le bien-voyant.
On appelle « simple script » un modèle
d’écriture calligraphique presque identique au modèle typographique.
Selon un contexte psycho-sociologique relativement
dépassé en Occident (C.Zaouche-Gaudron), mais toujours très marqué dans d’autres
cultures.
Pierre Faideau a contesté le symbolisme traditionnel
en faisant remarquer que la Droite et la Gauche peuvent se lire non par rapport
au scripteur, mais par rapport au tracé. La droite du tracé est au niveau
des jambages, la gauche, au niveau des hampes… Cette façon de voir originale
n’a, jusqu’à présent, pas été suivie par la communauté des graphologues (
Faideau, p.432).
Présentation céphalique
Occipito
Iliaque
Gauche
Antérieure (OIGA).