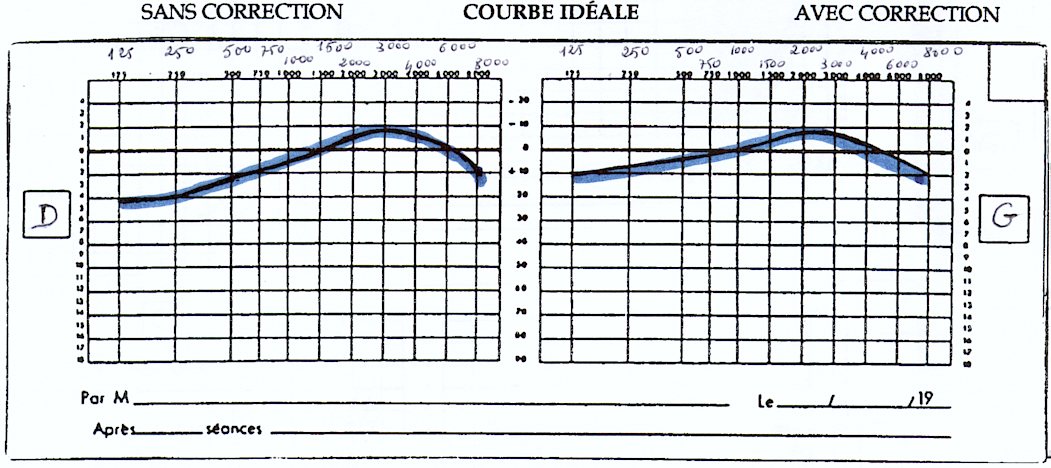
4.1 - La courbe aérienne
La courbe idéale est une courbe ascendante de 125 à 2.000 hertz avec une pente d'environ 6 DB par octave ; elle culmine entre 2.000 et 4.000 hertz, puis amorce une légère descente. Cette courbe définit le seuil d'audibilité. Les audiogrammes sont standardisés en redressant les minima afin que la courbe idéale apparaisse droite sur les diagramme, pour en faciliter la lecture. Toutefois, une petite élévation persiste entre 1.000 et 2.000 hertz malgré les 30 à 40 dB. accordés sur la courbe dans les graves et les aigus (fig. 10).
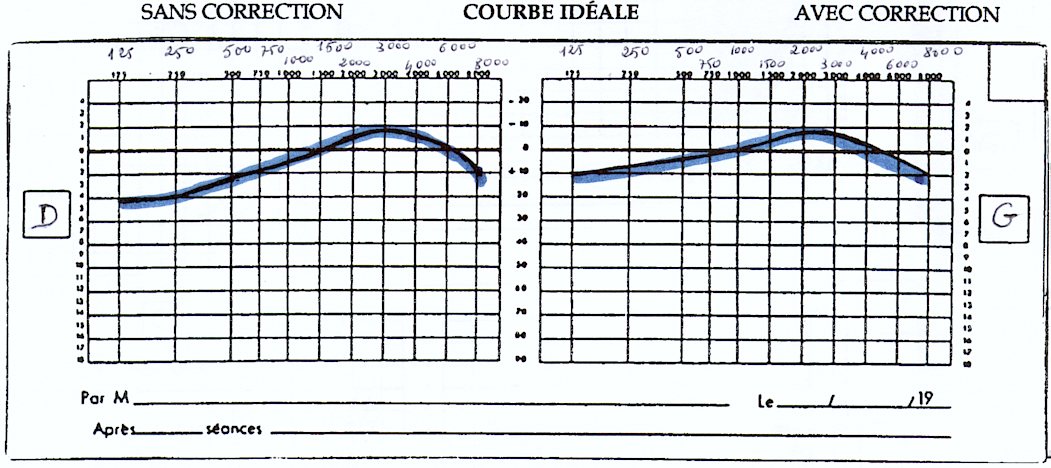
FIGURE
10
| |
Pourquoi
existe-t-il tant de variations au niveau des individus, notamment chez
les enfants, en dehors de toute pathologie héréditaire, organique ou
traumatique ? Nous avons avancé, à la suite de Feldman, que "nous ne réagissons
pas à tous les sons audibles provenant de notre environnement" et que "nous
portons des jugements affectifs sur une sensation sonore perçue et point sur
une autre". L'aspect relationnel par rapport à l'environnement et à autrui
serait à prendre en considération quant à la sensibilité auditive du sujet.
Nous devons de même tenir compte de la relation du sujet à sa propre corporéité
: la sensibilité auditive varierait au niveau de telle fréquence en fonction
du ressenti du sujet au niveau de chaque organe. Empiriquement, Tomatis et Bérard,
déjà cités, font état de distorsions par rapport à la courbe idéale à type de
pics, surélévations, pointes, qui pourraient témoigner de l'hyperaudition de
certaines fréquences spécifiques chez l'individu, ainsi que de scotomes, chutes
au niveau des courbes, évocateurs de retrait, repli, non-écoute, fermeture à
la communication concernant telle fréquence ou tel ensemble de fréquences (Statistiques
entreprises par le Dr. Descouens - ORL
de Toulouse - et nous-même 1989, 1990).
Une technique
audio-phonologique appropriée accompagnée d’un travail audio-vocal permettent
de redonner une dynamique à l'écoute, cette démarche pouvant précéder
une technique psychothérapeutique, ou bien de situer en parallèle avec cette
dernière.
4.2 - La courbe osseuse, via les cavités résonantielles du crâne et du rachis, rendrait
compte de la façon dont le sujet est à l'écoute de son monde propre, à la façon
d'une auto-écoute. Il y a certainement plusieurs modalités de cette écoute intérieure,
lieu de la vibration du verbe ou de la musique chez un sujet. La pédagogie de
la voix peut nous donner un aperçu de cette vibration en nous : lorsque
nous exécutons un « A » bouche ouverte et que nous refermons notre
bouche tout en maintenant notre vibration sur le A, nous commençons à ressentir
vibrer d’abord notre mâchoire, puis notre cou, puis notre thorax, et si nous
y mettons une intentionnalité, nous pouvons la prolonger dans le ventre et même
dans les jambes. Nous sommes traversés par la vibration et c’est un début d’exploration
de notre espace intérieur. L’artiste lyrique travaille ainsi de façon très fine,
et c’est aussi la façon de procéder des Mongols en chant_diphonique.
Une interview du compositeur Marcel Landowski (France Culture, Novembre 1991)
peut nous faire saisir ce que peut être l'écoute intérieure, à propos de l'écoute
imaginaire de Beethoven : « Comprendre et ressentir sans entendre le réel doit
donner de grandes libertés et du génie chez des sujets doués d'une grande imagination».
L’auteur fait certainement référence à la mise en forme du son en images acoustiques
(celles dont parle Saussure), le génie usant d’une prodigieuse mémoire et alliant ses productions
à des thèmes comme : la danse, la pastorale, l’hymne à la joie, l’héroïsme,
le destin… il s’agit là de concepts (le signifié).
Le sujet
doué d’inventivité nous montre que la création ne s ‘effectue pas toujours
par les voies du langage articulé et Beethoven devenu sourd nous apprend
que le talent est hors norme.
Si nous
nous situons hors du champ de la créativité, nous adressant à l’enfant et à
l’adulte que nous recevons dans notre pratique, nous pouvons dire que la courbe
osseuse représente l’écoute de l’intimité du sujet, de son monde fantasmatique, du pour-soi, mais aussi de sa propre
corporéité et de ses différents niveaux résonantiels, essentiellement corporels,
lieux où le langage n’est pas articulé ; en conséquence, la courbe
osseuse, qui croisera maintes fois la courbe aérienne, sera révélatrice des
somatisations du sujet, et en l’occurrence, nous nous sommes penchés sur l’asthme.
Il n'y
a en fait qu'une seule courbe idéale qui correspond à la jonction de l'écoute
" extérieure " pour l’Autre et de l'écoute " intérieure
" pour soi. Pour faciliter l'analyse
des résultats, les étalonnages des courbes aérienne et osseuse ont été volontairement
décalés d'environ 20 dB (fig. 11), déterminant deux courbes parallèles
séparées, la courbe aérienne devant être au-dessus de la courbe osseuse.
La disposition réciproque des deux courbes est étudiée, à savoir : la courbe
osseuse empiète-t-elle sur la courbe aérienne, et les points de croisement ont
leur signification. Ces deux courbes, reflétant l'écoute de deux mondes différents,
peuvent ne pas être parallèles.
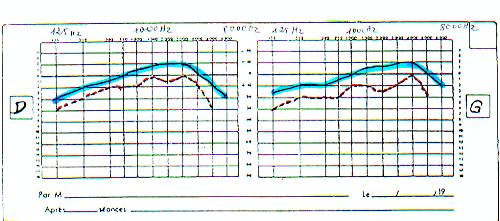
FIGURE
11
| |
précédent |
 |  |  |  |  |  |  |
18 Avril 2003