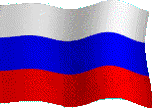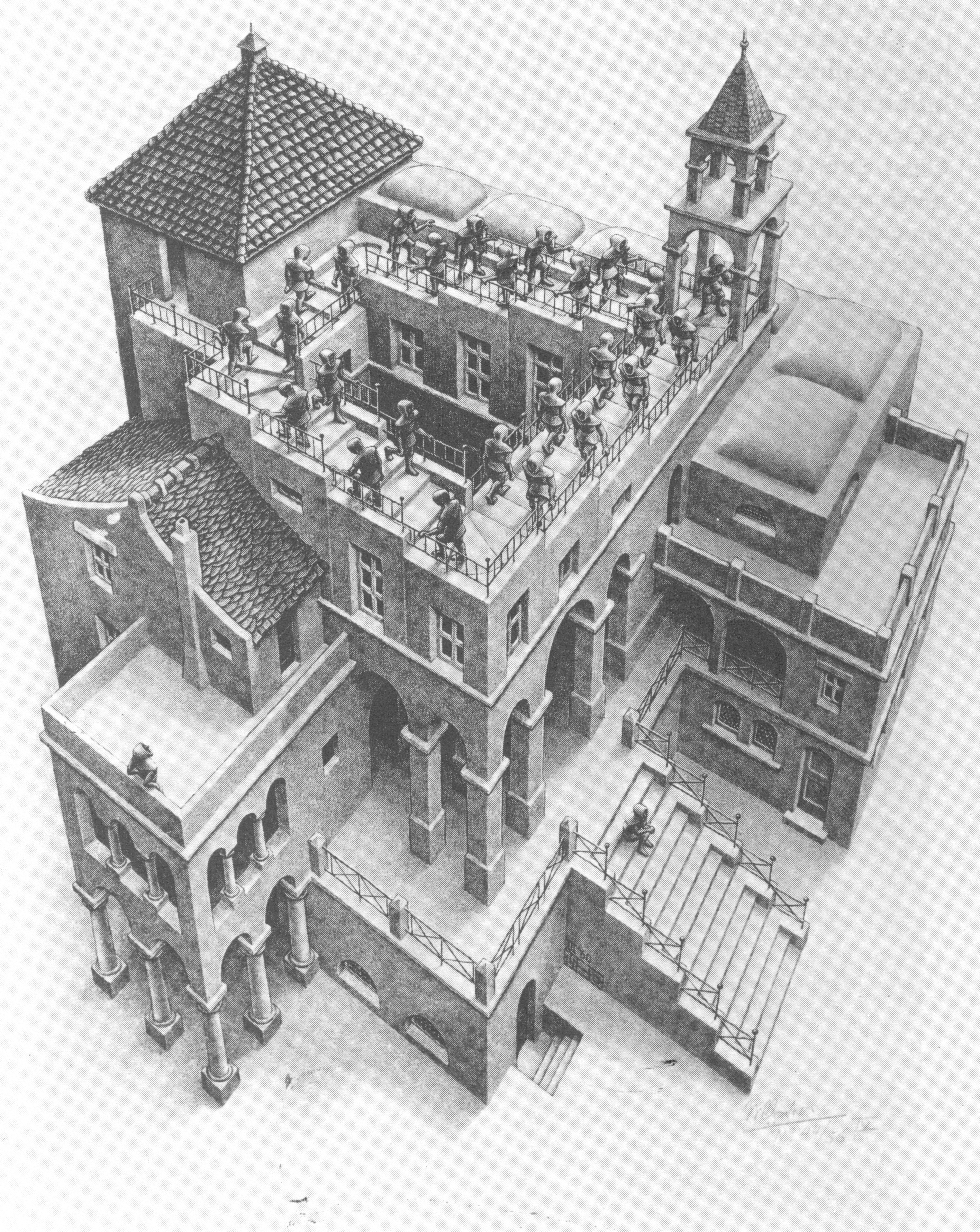La plupart des musiciens, s'ils n'ont pas
cette faculté, ont au moins la compétence d'évaluer l'écart de hauteur entre
deux sons (tierce, demi-ton, etc.). Chacun doit au moins percevoir la variation
d'une quarte (au moins son sens, sinon sa valeur) qui fait aller du do au
fa ou au fa dièse, par exemple...
Pourtant, même dans un orchestre professionnel,
on rencontre des exécutants qui ne peuvent le faire : si les sons présentés
sont purs, privés des harmoniques qui en font, d'habitude, des notes de musique,
des notes de tel instrument de musique, avec son timbre, sa physionomie bien
reconnaissable d'objet sonore, spécifiquement produit par le piano, la guitare
ou la contrebasse.
Ceci est particulièrement vrai des fréquences
supérieures à la plus haute note du piano : au-delà de 4 kHz. Les
erreurs, quand elles existent, sont presque toujours localisées dans cette
zone chez les professionnels de l'orchestre ou du chant. Il serait excessif
d'en conclure que ces fréquences sont non musicales ! Elles le redeviennent
pour peu qu'on éduque le sujet à leur écoute (Auriol, 1988b).
Tomatis (1974a), se basant sur l'hypothèse
que la capacité de différencier un son pur d'un autre serait fortement corrélée
au degré de sélectivité du système aux alentours de la fréquence choisie comme
terme de comparaison, a donné le nom de " fermeture de la sélectivité ",
" fermeture du diaphragme auditif " à ce phénomène qui
peut se manifester à tous les points de l'audiogramme ou seulement sur une
de ses portions. Harrison (1981) a fait remarquer l'impropriété du terme de
" sélectivité " pour désigner ce qu'il vaudrait mieux
appeler, comme l'admet Tomatis lui-même (comm. pers., 1975), la " sériation
fréquentielle ". On peut aussi bien utiliser le terme de CAT, ou
capacité d'analyse tonale, comme je l'ai suggéré au Congrès du RESACT (Auriol,
1988c).
Voici la méthode qu'il propose pour l'évaluer :
on fait entendre à l'une des deux oreilles du sujet un son pur, le plus aigu
disponible, avec une amplitude raisonnablement supérieure au seuil moyen,
puis un autre situé
|
A. Variation
de la fraction différentielle Df/d en fonction de la fréquence, à
40 dB (SL). La fraction différentielle est donnée en % en ordonnées.
Baisse de l'acuité relative au-dessous de 0,5 kHz et au-dessus
de 2 kHz. |
| B. Seuil différentiel
de fréquence Df d'un bruit de bande passe-haut en fonction de la fréquence
de coupure. A titre de comparaison, en tiret, courbe du seuil différentiel
de fréquence f d'un son pur. Fréquence de modulation 4 Hz. |
| figure 13 : Seuil différentiel
de fréquence (Buser, 1987) |
1/2 octave au-dessous et il doit indiquer
si les deux sons étaient de même hauteur ou si leur intervalle était de type
ascendant ou descendant... On recommence de quinte en quinte, depuis 8 000
jusqu'à 125 Hz. On opérera de même, ensuite, avec l'autre oreille.
Une durée de stimulation inférieure à 200
ms (Moore, 1973) peut rendre le test plus sensible, surtout pour les fréquences
au-dessus de 4 kHz. Pour certains intervalles, aucune différence de hauteur
n'est indiquée, ou même cette différence est évaluée dans le sens opposé à
sa réalité !...
Bérard (1982) indique que les résultats sont
à peu près les mêmes lorsqu'on présente les fréquences à comparer dans leur
ordre décroissant ou croissant... Il confirme, comme tous les usagers de ce
test, que les résultats varient peu dans le temps, à moins de choc psychologique
(fermeture) ou de thérapie sonique (ouverture).
Une oreille plus haute que l'autre ?
Si bien des sujets se révèlent incapables
de distinguer très clairement un son grave d'un son plus aigu, il en est aussi
pour déclarer plus haut tel son adressé à une oreille par rapport à ce même
son envoyé à l'autre. La " diplacousie " pathologique
consiste en ceci que l'auditeur, écoutant des deux oreilles simultanément
une fréquence pure, l'entend plus aiguë à une oreille qu'à l'autre. Il perçoit
simultanément deux hauteurs pour un même son. Ce trouble est assez fréquent
dans les phénomènes de dysmusie
et d'amusie.
La " variation latérale "
est un phénomène beaucoup plus fréquent et non pathologique d'un point de
vue ORL. On présente le stimulus à chaque oreille de manière séparée ;
l'auditeur doit indiquer si les deux sons ont la même hauteur ou si l'un est
plus aigu que l'autre. Le musicien peut annoncer fréquemment une différence
d'un demi ou même d'un ton ! Les déviations les plus grossières se situent
aux extrémités du spectre alors que, dans les fréquences " médium ",
elles sont généralement faibles (ce qui est homogène à tout ce que l'on sait
par ailleurs de la compétence auditive le long de l'échelle des sons). Ce
type d'erreur survient notamment quand la sensibilité d'une oreille
devient très inférieure à celle de l'autre oreille.
|
| Fig. 14. Diplacousie
d'un sujet " normal " (Buser, 1987). |
L'oreille droite étant soumise à un son de
fréquence donnée, on ajuste la fréquence appliquée à l'oreille gauche en sorte
que les deux sons paraissent de même fréquence. Le pourcentage de modification
de la fréquence, en + ou en -, est reporté en ordonnées, pour chaque fréquence
testée (Buser, 1987).
Leipp (1971b, 1977a) a remarqué la
fréquence de ce phénomène chez le sujet tout à fait sain d'un point de vue
ORL, et même chez le musicien compétent. L'erreur semble accentuée plutôt
qu'amoindrie lorsqu'on augmente l'amplitude, en passant par exemple de 30
dB (" piano ") à 60 dB (" mezzo forte ").
Il y aurait, d'autre part, une forte corrélation entre la diplacousie à une
fréquence donnée et la différence de valeur des seuils entre les deux oreilles
pour cette fréquence (Brink, 1970). Dans certaines affections ORL (maladie
de Ménière par ex.), on observe un taux d'erreurs très élevé. Si on compare
les musiciens avant et après une session de trois heures de prestation orchestrale,
on trouve des différences nettes : l'épreuve avant de jouer est normale,
détériorée (erreurs de l'ordre de 20 %) ensuite pour certaines fréquences.
On peut classer les sujets, pour chaque fréquence testée, selon leur plus
ou moins bonne performance ; la distinction entre musicien et non-musicien
montre un effet majeur de l'entraînement et une détérioration par le bruit.
Des facteurs individuels, le plus souvent d'ordre psychologique, influent
également sur les résultats ; les valeurs élevées sont sans doute à rapprocher
des diminutions de la capacité d'analyse tonale (CAT).
Leipp (1977a) a insisté, à la suite de Leconte
du Noüy, sur les variations du temps biologique par rapport à celui des horloges.
Quand une seconde de temps chronométrique est très remplie, elle paraît n'avoir
duré qu'une fraction de seconde, à un point tel que les 440 vibrations du
diapason ne suffisent plus à donner un la subjectivement recevable ;
et l'orchestre, aux moments de grande " intensité dramatique ",
aura tendance à jouer " plus aigu " pour rattraper ce
phénomène. " Quand le ton "monte" dans le drame, il monte
aussi à l'orchestre. " Symétriquement, les musiciens âgés auront
tendance à trouver que le diapason " monte " depuis leur
jeunesse, alors que c'est leur temps biologique qui se traîne.
On conçoit que ces remarques, associées à
une signification distincte de chaque zone spectrale (cf. chap. 12), puissent
jouer un rôle dans l'explication des variations individuelles et du fait que
certaines fréquences soient touchées chez un individu et d'autres chez son
voisin.
Signification psychologique de la capacité
d'analyse tonale
Le pilote, tout comme l'homme des bois, doit
être en mesure de déceler, répertorier, analyser et comprendre les subtiles
modifications d'un environnement sonore d'intérêt vital : la voix de
l'aiguilleur ou le frôlement du serpent minute. Comme la plupart d'entre nous,
il doit dégager les très légères modifications sonores, attendues ou redoutées,
de l'enfouissement où le tient un gigantesque bruit de fond. C'est le rapport
signal sur bruit qui importe, plus que le niveau brut perçu.
Tomatis (1974a) a montré l'énorme incidence
de la " fermeture de sélectivité " (erreurs d'analyse
tonale) chez un grand nombre d'individus : qu'il s'agisse de dyslexiques,
d'hyperkinétiques, de timides, etc. J'ai personnellement été frappé d'observer
ce phénomène chez des étudiants en musique ou même - quoique très rarement
- chez des musiciens sélectionnés au concours pour des orchestres symphoniques
de bon renom. Dans ce dernier cas, jouer correctement suppose un travail systématique,
répétitif et harassant.
Il a été démontré que la capacité à " catégoriser "
les sons phonétiques joue un très grand rôle dans l'apprentissage des langues,
de la lecture et de l'écriture correcte des mots. Il est évident que la discrimination
des fréquences ( et à un moindre degré des intensités) est ici une condition
favorisante. Une mauvaise discrimination des hauteurs conduit à toutes sortes
d'erreurs (Bradley, 1983).
Roblin (1987), à partir d'une étude sur des
élèves de 6e et 5e, a établi statistiquement (analyse des correspondances,
analyse discriminante, etc.) que la capacité d'analyse tonale droite et gauche
étaient liées, que les erreurs se regroupaient selon trois régions fréquentielles
(graves, médiums, aigus), que les aigus étaient plus facilement atteints que
les graves et l'écoute gauche plus que la droite. Il a pu dégager une valeur
prédictive sur les résultats scolaires (70 % de prévisions exactes concernant
le passage ou non dans la classe supérieure) égale à la valeur prédictive
des tests psychotechniques (lecture et orthographe, compréhension, aptitude
au raisonnement verbal, aptitude aux apprentissages de tous ordres). Ce sont
les mesures concernant la capacité d'analyse tonale pour l'oreille gauche
qui semblent les plus fiables.
On a donné une interprétation psychologique
de l'incapacité d'analyse tonale : elle traduirait une forte répression
(consciente ou non) de la communication affective, toutes émotions confondues.
Par exemple, une agressivité qui couve mais ne peut s'exprimer directement
ou un besoin de tendresse inassouvi et inexprimé, etc. L'expressivité sociale
semble liée à " l'ouverture " de la " capacité
d'analyse tonale " à un point tel que, lorsque le sujet se met à
percevoir les différences qu'il ignorait et à bien les situer, on observe,
de manière quasi constante, un changement du comportement remarqué par l'entourage :
" elle se met à sourire et parler ", " il devient
agressif ", " elle se met à fréquenter des tas de gens ",
etc., alors que le sujet lui-même peut rester inconscient du phénomène ou
le nier. L'enfant dont la capacité d'analyse tonale reste bloquée " est
comprimé ; il ne peut rien dire ; il est toujours doux comme un
mouton " (Tomatis, 1974a)... alors même qu'une très forte agressivité
" couverait " sous l'attitude inoffensive. Lorsque la
capacité d'analyse tonale s'ouvre avant que des problèmes de cette sorte ne
soient réglés par rapport à l'environnement immédiat, l'agressivité cachée
devient manifeste, explosive, inattendue ; elle vise alors spécialement
les images maternelles, le groupe comme tel, etc.
Tomatis (ibidem, p. 21) tend à attribuer à
une fixation maternelle très archaïque la difficulté à supprimer ce symptôme
de l'écoute. L'étude statistique que nous avons menée avec M. Bertin (Auriol
et Bertin, 1979) suggère un lien entre les tests de coordination visuomotrice
et l'ouverture de la capacité d'analyse tonale (en particulier pour " viser
une cible avec une balle " et la " rapidité pour tracer
des bâtons ").
Essai d'interprétation théorique de la capacité
d'analyse totale
Ces données disparates pourraient trouver
leur unité dans une interprétation se référant au vecteur haut-bas avec toute
sa généralité symbolique, telle que mise à jour par la psychologie des tests
projectifs de type réfractif (graphologie, tests de dessin en particulier),
le haut lié aux " valeurs ", à l'élévation, à l'intellect
et la spiritualité, le bas se rapportant au matériel, au grossier, au sensuel,
etc. (Duparchy-Jeannez, 1913 ; Pulver, 1931). Que pourrait bien signifier
cette compétence à hiérarchiser, à analyser le plus et le moins élevé ?
Il ne s'agit pas seulement d'évaluer une quantité (comme lorsque nous disons
que la tour Eiffel mesure plus de 300 mètres de haut), mais plutôt une situation
dans un repère vertical (Pierre, qui est au premier étage, est moins haut
que Paul déjà parvenu au troisième, alors même que Pierre serait un géant
et Paul un nain).
Distinguer le grave de l'aigu sans se contenter
de repérer la différence, être capable de la vectoriser dans une relation,
de lui donner sens, c'est tenter d'unir, sans le confondre, ce qui est le
plus difficile à unir : les profondeurs avec les hauteurs. " La
quantité pousse vers le bas, la qualité vers le haut, l'automatisme tire vers
le bas, le délibéré vers le haut. L'axe vertical est celui de la dialectique :
déterminisme contre libération, ou engagement contre abstraction. Sens hiérarchisant,
inégalitaire, qu'il n'est pas possible d'assumer par une responsabilité passive,
mais seulement en osant, au plus profond, être responsable de sa responsabilité
même ! " (Ditroï, 1977). Au repérage quantitatif convient un
critère quantitatif, symbolisable par un nombre cardinal ; au repérage
qualitatif convient un critère d'ordre hiérarchique, repérable grâce aux nombres
ordinaux.
La capacité d'analyse tonale pourrait aller
de pair avec la compétence ordinale. Elle permet de structurer la pensée et
les concepts qui la peuplent en un ensemble hiérarchisé. Au critère cardinal
correspondrait une vue plus élémentaire permettant le regroupement d'objets
dans des tiroirs conceptuels non hiérarchisés, sur la base, par exemple, de
la ressemblance à un prototype central utilisé comme référence locale. L'articulation
est ordinale. En l'absence d'une fine capacité de discrimination ordinale,
le champ de l'expérience vécue reste très largement dans le domaine imaginaire
et contingent, s'il est vrai, comme l'affirme Paillard (1987), que " l'aléatoire
et l'imprévisible ne sont définissables qu'en termes d'incapacité de la structure
d'accueil à reconnaître un ordre ou une régularité dans les phénomènes observés ".
Modification de la capacité d'analyse tonale
sous l'effet de l'entraînement
La sensibilité individuelle à la fréquence
est " susceptible de s'affiner grandement sous l'effet d'exercices
appropriés et, chez beaucoup de sujets, une très longue période d'entraînement
peut être nécessaire avant que les performances atteignent leur maximum "
(Wyatt, 1945 ; Demany, 1985). Les méthodes utilisant des appareils modificateurs
de l'écoute peuvent grandement contribuer à un tel changement. Au moins l'avons-nous
vérifié pour les erreurs d'analyse les plus grossières, qui disparaissent
plus ou moins rapidement, plus ou moins totalement et plus ou moins définitivement
chez la plupart des sujets soumis à ce type de cure.
Chroma, timbre et hauteur
Nous devons aborder ici une distinction intéressante,
mais que l'usage de mots, parfois peu clairs, rend un peu difficile. L'étude
des sons complexes amène à distinguer deux types de hauteur (hauteur du son
fondamental et timbre) ; la psycho-acoustique des sons purs oblige à
une distinction que nous avons déjà rencontrée et que recoupe la première :
hauteur brute et chroma.
Hauteur brute et chroma
Une énigme frappe dès l'abord : pourquoi,
lorsque nous entendons un son complexe, riche d'une multitude de sons élémentaires
ayant chacun sa propre " hauteur ", avons-nous l'impression
d'une hauteur d'ensemble ? Et pourquoi cette hauteur est-elle celle de
la composante fondamentale, y compris lorsque cette dernière est peu intense ?
Plus : il peut se faire que la composante fondamentale d'un son harmonique
étant totalement absente, d'intensité zéro, nous ayons l'impression que ce
que nous entendons est un avatar de cette fondamentale ! Le très jeune
enfant et les mammifères partagent avec nous ce " mystère de la
fondamentale absente " !
La saillance de la fondamentale d'un son complexe n'est donc pas liée à l'amplitude
de cette fondamentale elle-même (Seebeck, 1841) ; par contre elle est
d'autant plus importante que le nombre des composantes spectrales est plus
élevé.
L'ensemble des expériences impose l'évidence
que la hauteur fondamentale d'un son complexe résulte d'un travail sophistiqué
du système d'écoute et implique les structures nerveuses centrales :
l'argument décisif en est qu'à partir d'un harmonique à l'oreille droite et
d'un harmonique plus élevé à l'oreille gauche le sujet peut entendre leur
fondamental commun (Houtsma, 1972) ! On a montré aussi que nous sommes
capables d'entendre le fondamental à l'issue d'un mitraillage par ses harmoniques
présentés très rapidement mais sans se chevaucher (Hall, 1981). Plus encore :
en présence d'un son dont la fréquence n'est pas stable, mais qui oscille
de peu autour d'une fréquence donnée, notre système d'écoute s'arrange pour
en établir la moyenne et nous permet d'y associer une fréquence précise et
stable (Iwamiya, 1983).
| Les
deux hauteurs |
| Dénomination |
Chroma |
Tonie(Demany) |
| |
résidu |
timbre (Risset) |
| |
hauteur musicale |
corps du son (Kohler, 1915) |
| |
hauteur tonale |
hauteur spectrale |
| |
hauteur fondamentale |
hauteur brute |
| Fréquences |
de 60 Hz à 5 kHz |
de 20 Hz à 20 kHz |
| Domaine |
mélodique |
harmonique |
| Codage |
temporel (tonochronie) |
spatial (tonotopie) |
| Voix |
fondamental |
partiels et harmoniques |
| Oreille |
droite |
gauche |
| Type |
musicien |
mélomane |
| Musique comme |
langage |
jeu |
| Ecoute |
linéaire, analytique |
globale, synthétique |
| Hémisphère |
gauche |
droit |
Hauteur fondamentale et timbre
Les mélomanes attribuent comme hauteur à un
son celle de son " fondamental ". Les autres composantes
de la vibration (harmoniques, " partiels ") étant les
correspondants physiques du " timbre ". Ce dernier permet
ainsi, habituellement, de distinguer deux sons de même hauteur et de même
durée ; ainsi le do joué au piano sera-t-il différent du do joué au clavecin
ou à la trompette !
On sait depuis longtemps que l'oreille peut
nous faire entendre des sons inexistants : par exemple, si on joue sur
l'orgue les harmoniques d'une note à laquelle on ne touche pas, celle-ci est
" entendue " par notre esprit. Dans ce cas, la
vibration entendue n'existe physiquement nulle part, même pas dans l'oreille
comme certains avaient voulu le croire ! C'est notre système nerveux
qui construit cette information qui, d'ailleurs, n'exige pas nécessairement
un rappport tout à fait harmonique entre les sons réels fournis. Ce rapport
harmonique est en tout cas suffisant pour produire le phénomène, de telle
sorte que l'auditeur d'une musique filtrée en passe-haut (dont on a supprimé
les fondamentaux) peut fort bien la reconnaître et la fredonner !
Shepard (1964), puis Risset (1969a, 1969b,
1971), considèrent les deux types de hauteur dont nous avons déjà parlé :
la hauteur tonale (correspondant au concept familier de hauteur) et la hauteur
spectrale (liée à l'impact des harmoniques ou partiels simultanément présents).
En faisant varier, par ordinateur, ces deux paramètres en sens inverse de
manière astucieuse, ils sont parvenus à produire des illusions sonores (sons
paradoxaux) : son qui a l'air de monter ou de descendre toujours
(on reproduit ainsi sur le plan sonore une sorte d'escalier de Penrose, repris
par Escher (fig. 15).
En fait, nous ne sommes pas égaux devant ce
phénomène : l'oreille de certains se montre plus sensible à la hauteur
spectrale, celle des autres à la hauteur tonale. Les expériences de Charbonneau
et Risset (1975) suggèrent que l'oreille droite perçoit mieux les mélodies
tonales, cependant que l'oreille gauche est plus habile à suivre les mélodies
spectrales. Ces deux remarques pourraient amener à la construction d'un test
simple pour décider si une personnalité est plutôt attirée par les valeurs
émotionnelles de l'hémisphère gauche ou celles du droit (selon qu'elle se
base, dans son écoute, plutôt sur les successions spectrales ou tonales).
Nous avons testé, sur des sujets volontaires
considérés comme " sains ", deux types d'illusion sonore :
sons paradoxaux descendants qui donnent l'impression
de descendre sans fin et sons paradoxaux ascendants qu'on dirait monter toujours.
Ces essais furent conduits à notre cabinet et dans des stages de musicothérapie
avec R. Toupotte (juillet 1979). Le protocole consistait à présenter " le
son qui monte sans fin " ou celui " qui descend toujours ",
à un niveau relativement élevé et de manière répétitive, pendant au moins
dix minutes. Voici quelques-unes des réactions observées : plusieurs
participants, angoissés par les sons descendants, ont éprouvé une hilarité
incoercible pour les sons montants ; plusieurs soulignent que les sons
descendants ont défavorisé les mouvements respiratoires d'inspiration, alors
que les sons ascendants gênaient l'expiration.
|
| Fig. 15. L'escalier
de Penrose repris par Escher (Baken, 1987) |
Un homme (O. G.) emploie les qualificatifs
" pesant, désagrégeant, obsessionnel " (on retrouve ce
dernier terme dans un grand nombre de protocoles). Une jeune femme (N. A.)
a la tête qui tourne et se plaint de nausées. Elle a l'impression de tourner
en descendant comme Alice au pays des merveilles. Elle écrit avec difficulté,
éprouve une forte sensation d'angoisse avec oppression respiratoire, boule
à la gorge. A la suite de l'écoute, elle éprouve des difficultés d'élocution,
se sent " complètement paumée " : " Je
me trompe de numéro de téléphone, j'écris un mot à l'envers, sensation d'étourdissement,
d'être mal dans ma peau. " Plusieurs autres se plaindront d'impressions
nauséeuses ou vertigineuses.
Une jeune femme, Véronique, spécialiste de
techniques corporelles, écrit : " Impression de descente de
mon attention avec le son, de la tête vers le pelvis (ou bien je me l'imagine ?).
Envie que le son s'accélère, impatience ; je remarque qu'en fait le son
ne descend pas réellement, qu'il s'agit simplement d'une impression, qu'il
reprend au même niveau. Un peu frustrant comme être constipée ou vivre un
orgasme qui ne vient pas. " Un homme de 53 ans parle de danger :
" Ça va exploser, me détruire. J'ai les dents serrées. "
Cette impression, au niveau de la mâchoire, est attestée par plusieurs autres
auditeurs. Telle ajoute : " Je suis atteinte jusqu'au fond
de la gorge ; impression qu'on m'a percée jusque-là. " Plusieurs
évoquent la roulette du dentiste qui vibrerait au ralenti ! Berthe, 32
ans, trouve l'écoute pénétrante, agaçante, et sent, comme bien d'autres, monter
en elle la colère, l'envie d'agresser.
Telle personne, incapable de supporter le
son paradoxal descendant, quitte la pièce, mais écoute le son paradoxal ascendant.
Trois auditeurs refusent les sons paradoxaux ascendants : " Insupportable
torture ", " torture infinie appliquée par petites doses
successives ". Une jeune fille de 25 ans écrit : " Quelque
chose de terrible va se produire, bruit annonciateur d'explosion. Si je m'abandonne
bien : plaisir d'une puissance qui gonfle, qui monte en moi ; de
plus en plus grand, de plus en plus fort. Je remplis l'espace avec, en arrière-goût,
la crainte d'éclater : un plaisir dangereux. " " On
a soif et pas le temps de se désaltérer ; on reste sur sa faim sans pouvoir
l'assouvir, en un perpétuel état de qui-vive. On est dans une course folle
qui m'évoque ce personnage d'Orange mécanique qui pousse sa voiture au maximum,
écrasant tout sur son passage avec un sadisme terrifiant. Mal à la tête, envie
de vomir, point douloureux dans le dos. Après les quinze minutes d'écoute,
j'ai mal aux oreilles et la tête lourde. Je ressens un point de sensation
forte pulsative, qui lui n'est pas désagréable du tout... " Après
un moment de " tension vers un but, de montée d'une catastrophe,
je sentais comme une joie qui montait et voulait éclater ; j'aurais aimé
que ça se prolonge ". Pour une autre jeune femme (J. T.), cette
séquence est plus supportable, elle éveille un sentiment d'espoir " dû
à l'ascension ". Un participant (O. G.) parle de " tension
inassouvie ". Une auditrice souligne qu'après l'écoute elle éprouve
une impression de manque, d'avoir " perdu quelque chose ".
Un homme de 53 ans : " Ça devient très lumineux, de plus en
plus vite. Après la fin de l'écoute, j'ai envie de rester immobile, dans le
silence, fatigué et paisible. " La sensation " de plus
en plus vite " est fréquemment retrouvée dans les comptes rendus.
Certains participants énoncent une modification de la durée apparente, soit
que cette séquence ait paru plus courte, soit qu'elle ait paru plus longue
que sa durée chronométrique de quinze minutes.
| Sons
descendants |
Sons
ascendants |
| Colère,
agressivité. |
Espoir,
joie. |
| Sensation
d'être agressé (e). |
Sensation
de puissance. |
| Etre
agressé(e), être pénétré(e) |
Sadisme,
pénétrer |
| de
la tête au pelvis. |
du
pelvis à la tête |
| Angoisse,
dents serrées, gorge nouée. |
Sur
le qui-vive. |
| Vertige.
. |
Remplir
l'espace |
| Poids,
chute. |
Lumière,
vitesse. |
| Expiration.
. |
Inspiration |
| Difficulté
d'élocution et d'écriture. |
|
| Tendance
à inverser les mots. |
Ces remarques invitent à penser que les sons
paradoxaux sont généralement source d'angoisse, mais cette angoisse varie
avec la personnalité et le caractère ascendant ou descendant du phénomène
de la pesanteur.
Le test de discrimination temporelle de Leipp
(delta t)
Tel sujet, comme le remarque Leipp (1978)
distinguera nettement des impulsions sonores très rapprochées ; tel autre,
par contre, les fusionnera en magma informe ! C'est dire que le premier
perçoit dans une même séquence, tant soit peu complexe, beaucoup plus d'informations
que le second ! Il propose donc de mesurer le pouvoir séparateur temporel,
c'est-à-dire la durée maximum de silence inaperçu entre deux clics sonores.
La capacité de discrimination temporelle est
évaluée de la façon suivante : on fait entendre dix séries de cinq clics,
identiques entre eux, mais séparés les uns des autres par un temps de silence
variant de 2 à 250 millisecondes. On demande au sujet de tracer un bâton pour
chaque son entendu, en espaçant ces traits plus ou moins selon que les clics
étaient plus ou moins rapprochés. Lorsqu'un intervalle n'est pas perçu, le
sujet, fusionnant deux sons en un, omettra un bâton : nous pourrons ainsi
noter comme inaperçu l'intervalle silencieux correspondant. Par exemple (en
désignant le premier clic par C1, le deuxième par C2, etc., et le silence
entre deux clics par sa durée évaluée en millisecondes) : C1-20-C2-250-C3-100-C4-5-C5.
Nous retenons comme valeur du test (delta
T) le plus petit intervalle perçu de manière stable. La norme, relevée sur
quelque 300 sujets, jeunes, musiciens, est située entre 25 et 50 ms, les valeurs
extrêmes étant d'environ 5 et 100 ms. Ce pouvoir séparateur est susceptible
d'entraînement, par exemple il s'améliore chez les accordeurs de piano !
On peut aussi s'intéresser à la compétence du sujet pour noter convenablement
les différences entre intervalles, autrement dit sa perception du rythme (Oléron,
1959 ; Stambak, 1960). La séquence donnée en exemple plus haut (C1-20-C2-250-C3-100-C4-5-C5)
devrait amener le sujet à écrire :
I
I I II
Bassou (1983) insiste sur la possibilité de
deux attitudes dont la deuxième est beaucoup plus performante que la première :
dans un cas, le sujet réalise un décompte immédiat des événements sensoriels
qu'il doit dénombrer, dans l'autre il reçoit globalement l'ensemble du message
et y repère des formes (qui peuvent servir à un dénombrement s'il y a moins
de six événements). Ici, comme dans le test dichotique (cf. chap.
6), il existe une nette dissymétrie entre les deux oreilles (oreille gauche
orientée vers la "forme" du stimulus, oreille droite vers le "dénombrement").
Bassou et Urgell proposent de modifier le
test en utilisant une seule durée de silence entre les clics d'un même essai
qui seront administrés en nombre variable (de 2 à 5) : le sujet pourra
se contenter de les compter sans avoir à reproduire un rythme. On part de
durées entre clics très faibles et on les augmente, à chaque pas, de 20 ms.
Par exemple : clic 1-20 ms-clic
2-20 ms-clic 3 / clic 1-40 ms-clic 2 / clic 1-60 ms-clic
2-60 ms-clic 3-60 ms-clic 4-60 ms-clic 5 / etc.
Les réponses du sujet devront être :
3, 2, 5. Cette façon de faire a l'avantage de systématiser le protocole (en
dissociant le problème de la transcription du rythme et celui de la perception
des silences selon leur durée). On appelle la plus petite durée perceptible
le " delta T " de la personne testée. Dans ce cas, on
évaluera séparément l'aptitude à percevoir les rythmes selon l'épreuve de
Stambak : on fait entendre au sujet une série de sons frappés selon un
certain rythme et il doit en reproduire la séquence (les intervalles entre
coups frappés sont bien marqués, de telle sorte qu'il n'y ait confusion pour
personne entre deux sons successifs). La durée minimum perçue (delta T) se
situe généralement autour de 40 ms (Godin, 1985), mais s'améliore beaucoup
par l'entraînement de l'écoute, de sorte que les musiciens professionnels
détectent des intervalles inférieurs à 10 et même à 4 ms, et se montrent beaucoup
plus stables dans leur évaluation que les sujets moins entraînés. Leur détection
est à la fois plus sensible et plus fidèle. En clinique, les réponses vont
de l'incapacité totale à dénombrer les clics à la possibilité d'en reconnaître
la séquence exacte pour un delta T allant de 2 à 500 ms.
Se pose la question de savoir si le test évalue
les capacités temporelles du système oreille/cortex auditif. Ou doit-on lire
son résultat comme un reflet plus global ? Par exemple, si le delta T
est à 100 ms, doit-on en inférer une simple lenteur " auditive ",
cependant que les processus visuels, tactiles, psycho-moteurs auraient une
résolution temporelle différente ? Ou bien devrons-nous conclure à une
sorte de " paresse " du système nerveux central dans son
ensemble ? S'agira-t-il d'une lenteur de fonctionnement de chacune des
unités nerveuses (neurones, synapses) ou bien d'un ensemble fonctionnel comportant
un " chemin " plus ou moins long (empruntant des voies
plus ou moins compliquées, détournées), ou encore d'un traitement de l'information
faisant intervenir pratiquement toutes les structures encéphaliques ?
Un cas particulier
Pour clarifier cela, nous examinerons - en
résumant beaucoup - un cas qui nous a frappé, celui d'une de nos patientes,
Line Liendretta, dix-huit ans, étudiante en secrétariat. Elle avait de grandes
difficultés dans ses études et depuis un an était prise de crises de bâillements.
Son cas est sans doute celui d'une hypersomnie qui, à l'époque des faits,
n'était pas explorée. Six mois plus tard, on diagnostiquait une discrète hypothyroïdie
sans augmentation de la stimuline hypophysaire de la thyroïde (TSH) et divers
troubles hypophysaires mineurs. Le dysfonctionnement hormonal et l'hypersomnie
se sont amendés au cours du traitement sonique : ils n'étaient donc pas
pas liés à une quelconque organicité. On admet alors qu'ils étaient déterminés,
pour l'essentiel, par ses expériences précoces, sa biographie et par de nouvelles
exigences familiales et scolaires. Elle se dépeint comme pessimiste, méticuleuse,
surtout depuis quatre ou cinq années. Elle note ses fréquents conflits avec
son père, qu'elle trouve irritable, dépourvu de toute patience !
Remarquons à quel moment s'est considérablement
aggravé ce tableau de dysendocrinisme fonctionnel, à quel moment apparaissent
les troubles psychologiques de type dépressif ayant entraîné la consultation
du psychiatre. C'est quand elle doit passer de l'apprentissage des signes
sténo à la rapidité. Elle est alors perdue et demande grâce : " J'ai
été fatiguée dès que j'ai fait de la sténo "... " la sténo
me crève, c'est trop rapide "... " la sténo m'a complètement
refroidie ". Auparavant, malgré la lenteur qu'elle se connaissait
et qui l'amenait à passer bien plus de temps sur ses devoirs que ses compagnes,
elle " assurait " ; lorsqu'il faut impérativement
accélérer le rythme, faire, non très bien, mais très vite, tout est fini pour
elle, sa scolarité est interrompue et elle ne pourra reprendre qu'après une
cure sonique méthodique et l'aménagement de ses perspectives professionnelles.
Or, son delta T est supérieur ou égal à 100
ms, ce qui est une valeur extrême, très rarement trouvée. Par contre son audiogramme
tonal est proche de la norme et sa capacité de différencier les fréquences
est de bonne qualité. Cette observation clinique simple paraît militer en
faveur de liens très larges entre le delta T et d'autres données temporelles
concernant la vie cognitive dans son ensemble.
Des constatations statistiques
Eila Alahuhta (1986) a clairement établi que
les capacités d'analyse temporelle sont, au moins en partie, fonction d'un
harmonieux développement foetal et d'une naissance sans problème : en
effet, les élèves à tests défectueux au niveau temporel avaient, bien plus
souvent que les autres, un score d'Apgar inférieur à 9 (on sait que cette
note reflète un certain degré de souffrance neurologique évalué immédiatement
à la naissance). Les troubles de l'analyse temporelle, ou son manque de finesse,
peuvent, pour le moins, rendre compte de certaines confusions linguistiques
(voisé/non voisé, par ex.) et, plus généralement, nuisent à une bonne intégration
de l'information sonore, en particulier linguistique. Eila Alahuhta (1980,
1986) a démontré que la capacité de décodage des structures rythmiques entendues,
mesurées en fin de maternelle, sont prédictives du succès ou de l'échec ultérieurs :
notes de rédaction, de mathématiques, de lecture et de musique (au cours des
quatre premières années) et, plus tard, réussite ou difficulté en langues
étrangères et en mathématiques. On peut y ajouter diverses capacités " scolaires "
telles que : désir de lire et d'écrire, exactitude de la rédaction,
compréhension du langage écrit, faculté de comprendre des instructions orales.
La corrélation est également très positive avec les futures qualités expressives :
sens du rythme, naturel de la parole, capacité à jouer du théâtre, réalisme
des proportions spatiales, aptitude à reproduire des dessins ou des schémas.
Elle a même pu corréler le lien des capacités d'analyse temporelle préscolaires
avec l'autonomie dans le travail et la concentration mentale.
Tout ceci montre l'intérêt d'une éducation
- et d'une rééducation ! - des facultés d'analyse auditive temporelle
(éducation musicale, musicothérapie, rééducation sous appareil modificateur
d'écoute).
Conclusion
Les tests de perception du rythme et des capacités
temporelles du système d'écoute sont très utiles dans l'évaluation des capacités
scolaires, notamment linguistiques. Un delta T élevé peut signaler une sorte
d'inertie, de blocage (comme chez Line). Ce dépistage est d'autant plus utile
que nous savons pouvoir faire progresser, par l'entraînement, de tels sujets
et leur permettre ainsi d'améliorer considérablement leur compétence scolaire.
On trouvera d'autres informations dans le travail de Raufaste.
Chapitre
suivant : Effets du son sur l'être
humain
Retour au Plan
©
Copyright Bernard AURIOL (email :
)
12 Juillet 2008